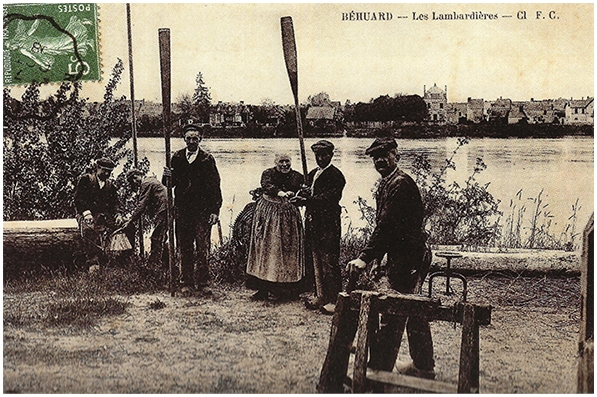BATI BUHARDAIS
- Accueil
- ORIGINES
- HISTOIRE
- BATI- ACTIVITÉS
- EGLISE
- PELERINAGE
- Maison Diocésaine
- A propos
Lombardières- SAVENNIERES- La Roche-aux-Moines - Le Moulin du Fresne- Épiré
Le Bourg
Le bourg d'après le cadastre napoléonien
Plan du bourg aujourd'hui
Réalisé autour de l'église, le bourg se caractérise par des voies étroites qui participent au charme de ce village. Les maisons des rues principales, rue du Chevalier Buhard et rue de la Prairie sont construites à l'alignement des voies dont la direction est soulignée par les faîtages parallèles au réseau. La rue de la Boire est moins dense avec des maisons précédées, sur rue , de jardins. La rue Notre Dame résulte des aménagements du XIXe siècle et de la réalisation de la maison des Petits Clercs sans commune mesure avec l'habitat traditionnel
Le parcellaire, en bandes souvent étroites et perpendiculaires à la voirie, est occupé, à l'arrière des maisons, par des jardins.
Place de l'Église
Au débouché de la rue du Chevalier Buhard, la place a conservé son ambiance de cité médiévale.

Cependant, on remarque la modification des toitures du Logis du Roi qui a perdu sa couverture à croupe et a été rehaussée.
De très belles maisons, dont deux sont classées, ont été préservées.
La suppression du parking permettrait de redonner un espace intéressant au cœur du bourg. Des plantations reprenant l'ancien parcellaire redonneraient l'échelle de la place.
Rue du Chevalier Buhuard

Aujourd'hui beaucoup de lucarnes ont disparu et il n'y a presque plus de plantes grimpantes sur les façades. Les enduits chaux ont été remplacés par de tristes enduits ciments. Il faudrait redonner de l'animation et les couleurs blondes des façades.
Rue de la Prairie
La rue de la Prairie fait le lien entre le centre du bourg et les prairies.
Nous y retrouvons la typologie de la rue du Chevalier Buhard avec les maisons alignées sur la rue. L'accès depuis la place est marqué par la terrasse de l'ancien café bordé de murs et d'emmarchements cimentés.
Rue de la Boire

Elle part du centre du bourg. A la différence des rues du Chevalier Buhard et de la Prairie, les maisons d'habitation se situent en retrait de la rue avec de petites dépendances le long de la voie.
Cette rue se prolonge au-delà du bourg par le lieu-dit « Les Sablons»
La rue Notre Dame et le Clos du Calvaire
Le côté sud est longé par les jardins arrières des maisons de la rue du Chevalier Buhard. Cette voie est intéressante pour le patrimoine traditionnel de fours et de puits qu'elle nous révèle. L'ancienne école, joli petit édifice public du XIX°, donne aussi sur cette rue. Le Clos du Calvaire, destiné à l'accueil des pèlerins et la Maison des Petits Clercs, ont été réalisés en rupture avec ce parcellaire traditionnel.
.
Entre le Clos du calvaire et la Maison des Petits Clercs , un ensemble intéressant avec un grand four à chanvre tombe en ruine.
![]()
LES HAMEAUX
Le Bois

La situation, à proximité de la cale où débarquaient les voyageurs venus par train pour rejoindre Behuard, a fait évoluer de façon particulière cet ensemble rural déjà implanté au XVIII°. Des maisons de plaisance alternent avec l'habitat traditionnel
Le hameau du Bois se distingue par le type d'habitat varié et son parcellaire qui converge vers lacale de laGuillemette. Les cartes postales, éditées à l'occasion d'un important pèlerinage au début du XX° siècle, témoigne de l'aspect du hameau à cette époque.
Le Haut-Grivaux
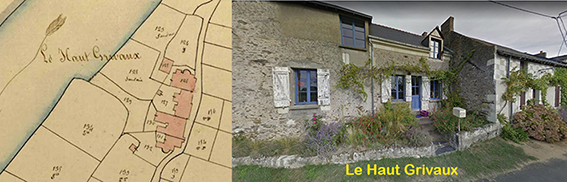
Le Haut-Grivaux est un ensemble de trois maisons sans étage alignées sur la bute et d'une maison en retrait surélevée d'un niveau. Les dépendances s'étendent sur l'arrière suivant les bandes des parcelles.
Le Bas Grivaux

Les façades principales rectilignes sont orientées au sud
Les deux ensembles sont construits sur le même mode avec des maisons alignées aux combles parfois pensés de lucarnes passantes. Les faîtages sont parallèles à la rue. La plupart des maisons ne comportent qu'un rez-de-chaussée. Une maison de maître à deux niveaux fait exception dans la ferme.

Le Bas-Grivaux comporte deux entités : une ferme qui s'étendait autrefois le long d'un chemin aujourd'hui dévié et le lieu dit « le Dreffoux » occupé par plusieurs habitations.
Le Merdreau

A chaque maison de ce hameau correspond une petite bande parcellaire.
Le Merdreau est constitué de maisons qui, à l'origine, étaient semblables à celles du Bas et du Haut Grivaux. Si l'implantation en bande des maisons orientées Nord-Sud a été conservée, la volumétrie a été profondément modifiée par l'ajout d'un étage sur chacune d'elles..
Les Chalets
Les Chalets de la Petite Burette

Au-delà de la Maison des Petits Clercs vers l'Ouest, les maisons sont implantées le long de la Loire. Certaines sont anciennes dont une très belle du XVIII suivie de quelques maisons traditionnelles.
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont marqués par l'implantation de résidences secondaires entre le Merdreau et le bourg. Ces maisons font l'objet de décors soignés de pierre, de briques et de charpentes ouvragées, de faitages et d'épis de toiture métalliques sophistiqués. Elles sont construites sur des tertres aménagés en terrasses et traités en jardins soignés.
Behuard, 3, rue Petite-Burette
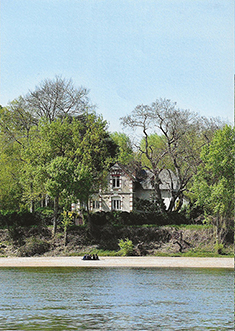
Cette villa fut construite vers 1915 pour Georges Ménard, marchand de liqueurs, installé au 82, rue de Bressigny à Angers. Bien que d'auteur inconnu, cette maison en brique et pierre n'est pas sans rappeler la villa Mon Repos, construite dans les mêmes années à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Le pavillon nord est une adjonction récente.
Villa Les Mouettes
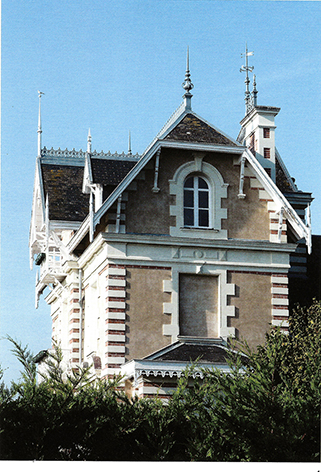
Construite pour Jules Métivier, quincaillier , installé 14, rue des Poêliers à Angers, la villa Les Mouettes constitue avec une demi-douzaine de maisons Behuardaises un ensemble de chalets édifiés au tournant des années 1900 sur la berge sud de l'île, au lieu-dit le Merdreau. La demande d'autorisation de construction auprès du service des Ponts et Chaussées date de 1898. La maison, bâtie par l'architecte choletais Victor Rabjeau père (1859-1937), est mentionnée dans la revue Le Béton armé la même année. Les concessionnaires Hennebique, Grolleau et Tranchant mettent ici en oeuvre l'une des premières structures en béton armé connues dans le Maine-et-Loire pour la semelle de fondation de la maison, les linteaux et les poutres de plancher. Par son jeu de toitures (pavillon, toit à longs pans, demi-croupe), la présence de ses fermes débordantes et la polychromie de sa façade sur Loire. Les Mouettes s'affirme comme l'une des villas les plus intéressantes de la confluence. Si Victor Rabjeau était essentiellement connu pour sa maîtrise du nouveau procédé Hennebique, il démontre ici qu'il savait aussi dessiner de belles demeures.
Behuard, villa La Comète
 Ce petit chalet peut être considéré comme l'une des premières maisons de villégiature de Behuard. Construit en 1890 par Henri Brochet, un ferblantier installé rue Rabelais à Angers qui fit apposer son monogramme en fer forgé sur les souches de cheminées, il apparaît encore seul sur certaines cartes postales éditées avant 1898, date de construction de la villa Les Mouettes qui le jouxtera bientôt à l'est.
Ce petit chalet peut être considéré comme l'une des premières maisons de villégiature de Behuard. Construit en 1890 par Henri Brochet, un ferblantier installé rue Rabelais à Angers qui fit apposer son monogramme en fer forgé sur les souches de cheminées, il apparaît encore seul sur certaines cartes postales éditées avant 1898, date de construction de la villa Les Mouettes qui le jouxtera bientôt à l'est.
Bâtie sur une terrasse surplombant la Loire, la maison, de plan carré, s'élève sur deux niveaux: un rez-de-chaussée surélevé auquel on accède par quelques marches et un étage de comble. La façade, à pignon sur le fleuve, est percée au rez-de-chaussée de quatre baies à encadrement de tuffeau, aux couvrements légèrement cintrés, que surmonte une fenêtre avec balcon en fer forgé. Sa maçonnerie était jadis recouverte d'un enduit et seul les chaînes d'angle, les encadrements des baies et un bandeau en tuffeau qui les relie étaient saillants. Ils participaient au décor avec les lambrequins de la toiture, couverte d'ardoises, l'épi de faîtage et la polychromie des cheminées en brique et tuffeau, Au-dessus de la baie de l'étage de comble, une statue de Notre Dame rappelle la dévotion dont elle fait l'objet sur l'île.
Behuard, villa Le Reposoir

La villa Le Reposoir fut construite en 1899 pour Valentin Gazes, grainetier, installé au 23, boulevard Carnot à Angers . Elle présente une harmonieuse façade alternant assises de brique et de tuffeau à laquelle est associé un décor de bois découpé amortissant la ferme débordante centrale et les lucarnes latérales . La maison fut augmentée d'un garage et d'une chambre en 1915. En 1932, elle est acquise par Auguste Droue, directeur des Verreries mécaniques de Bretagne à Vertou (Loire-Atlantique).
![]()
Lieux Dits
Le Moulin du Fresne
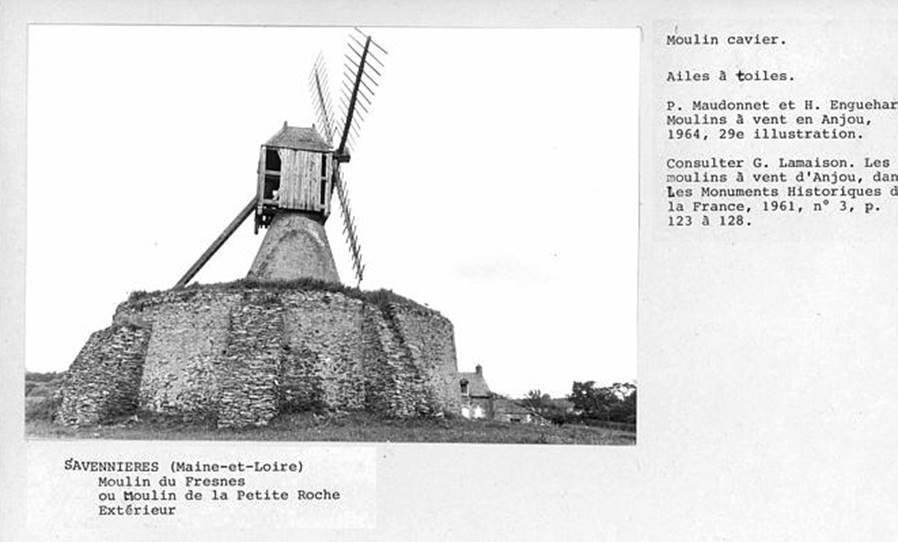
Le moulin à vent du Fresne à Savennières (édifice inscrit à l'inventaire des monuments historiques) est visible depuis le chemin qui mène au bout de l'île en passant par le Bas Grivaux.
La Roche aux Moines
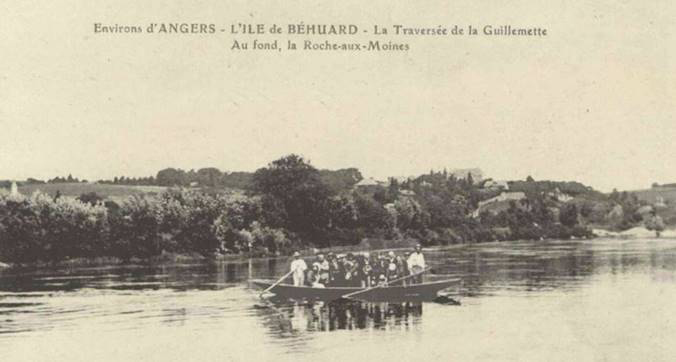
Depuis les chemins qui sillonnent la pointe Nord Est de l'ile, un panorama remarquable se découvre sur les reliefs escarpés de la Roche aux Moines et les Logis de la Coulée de Serrant et de la Cour à Savennières
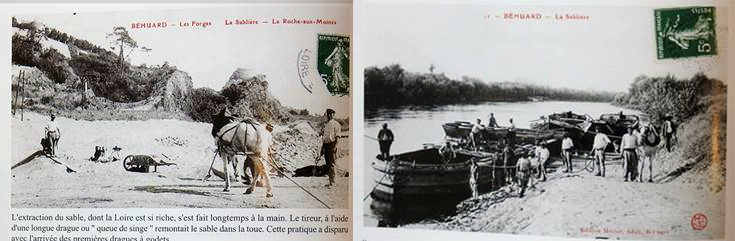
Le port du Bois

Une belle rame de mise à l'eau et un ponton d'embarquement de pierre bien conservés rappellent la traversée par bateau qui permettait d'accéder à Behuard. Les installations ont été préservées sur les deux rives. Ce passage correspond à la gare du chemin de fer des Forges sur Savennières. L'ensemble, constitué par les installations des deux rives (y compris les fermes situées de part et d'autre et l'ancien café de la gare), est un témoin important de l'histoire de Behuard et des activités qui s'y sont développées.
![]()
Les Caractéristiques de l'Habitat Traddditionnel
Les maisons de Behuard, disposées en hameau, ont été construites sur les points hauts de l île ou sur des tertres. Ce patrimoine est composé de petites maisons à l'échelle d'une petite commune. Caractéristique des zones inondables de la Loire, cette architecture simple, réalisée avec des matériaux naturels : la chaux, la pierre de tuffeau, le schiste et le bois est menacée par l'intrusion de matériaux de l'industrie d'aujourd'hui, incompatibles techniquement et esthétiquement, avec la construction traditionnelle, tant du fait de la texture que de l'aspect.
Par ailleurs, l'organisation de cet habitat répondait à des usages aujourd'hui disparus. Il subsiste un patrimoine fait de fours, de puits, de séchoirs, de murs, de dépendances diverses en cours de disparition qu'il serait intéressant de préserver.
Les murs :
L'alternance du schiste enduit et du tuffeau
Les façades des maisons traditionnelles de Behuard sont caractérisées par l'utilisation de schiste enduit et du tuffeau. Cette répartition entre schiste et tuffeau varie d'une maison à une autre et crée une diversité intéressante à préserver .Le tuffeau craignant l'humidité est plutôt réservé à l'étage
Les encadrements et corniches :
Le tuffeau est utilisé pour les chaines d'angle, les encadrements , les corniches
Les souches de cheminées :

Le tuffeau est utilisé pour les chaines d'angle, les encadrements , les cornichesen briques enduites ou jointoyées; les souches de cheminée des pignons font aussi partie de la silhouette maisons.
Les escaliers

Caractéristiques des maisons situées en zone inondable, les escaliers extérieurs; réalisés en maçonnerie de moellon enduite à la chaux avec dessus des marches en ardoise, sont bordés de murets enduits à pierre nue formant rambarde.
De nombreuses maisons comportent des surélévations qui ont été réalisées en tuffeau, parfois disposés en damier.
Les toitures :
Toutes les couvertures des maisons ou dépendances sont traditionnellement réalisées en ardoises naturelles
Les formes :
sont simples, à deux pans avec faîtages alignés, pour les maisons en bande.
Les corniches sous toiture

Les égouts de toiture reposent souvent sur des corniches moulurées mais peuvent aussi être traités en débord.
![]()
Un Monde de Paysans
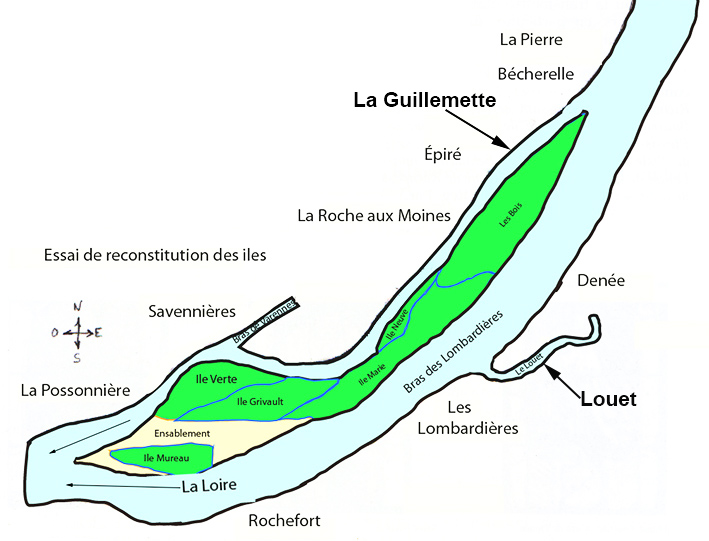
Si la population de Behuard est maintenant agricole, il n'en était pas de même aux siècles derniers et ,à part quelques fermiers ou « marchands-fermiers », tels ces Cady et ces Marais et ces Richou dont les terres passèrent de père en fils pendant plus de huit générations, les ancêtres des cultivateurs d'aujourd'hui avaient une vie différente. Tous étaient bateliers... La marine faisait leur bonne et leur mauvaise fortune.
Aux pêcheurs de Behuard, retenus chez eux par la mauvaise saison, se joignaient souvent d'autres mariniers de la Loire immobilisés près de l'île, par de mauvais courants ou des vents contraires. Ils hibernaient ensemble et sans souci de bien-être, partageaient la nourriture et le gîte jusqu'à ce que les vents redevinssent favorables...
1738. Dans cette année, l'isle de Behuard a été inondée dans le mois de juin, et les lins et bleds totalement perdus. Il y avait 70 feux et environ 230 communiants. Beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui.
1739. Cette année 1739 estoit très chère ; le bled sègle vallait 40 sols le boisseau, et le bled froment 50 sols ; toutes les denrées estoient très chères ; le vin valoit 60 livres la pipe et le peuple accablé par les taxes estoit dans la dernière pauvreté. Abondance d'alozes en ce temps mais à vil prix. Le roy s'est emparé cette année de l'isle Mureau à l'antier pour le domaine. Dans ce mois de juillet 1739, la récolte a été très abondante en bleds ; le temps très propre pour les foins, mais aucun fruit, ayant esté gelés en avril à l'antier. Les vignes n'ont aucune apparence et menacent d'une stérilité totale.
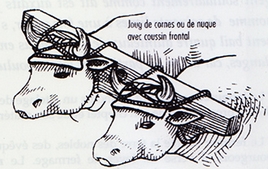
Dans cette année 1739, M. le curé de Denée , m'a vendu la coupe de léards (peupliers) et autres arbres pour la somme de 25 livres. La disme de Behuard était possédée autrefois par mes prédécesseurs, à raison de 60 livres et douze poids de chanvre qu'ils reportaient à M. le curé. La dite disme faisait leur revenu avec douze boisselées de la chaintre (passage) joignant le bois.
Signature d'un Bail
22 novembre 1754. René Richou et son fils,laboureurs à Behuard, signent un bail à ferme avec les religieux de Saint-Nicolas d'Angers.Archives de Serrant : transcription de 3 pages d'un acte notarié, avec en entête un timbre à fleurs de lys, au nom de la Généralité de Tours (accents et ponctuations ont été rajoutés pour faciliter la lecture)
Le vingt deuxième jour de novembre mil sept cent cinquante-quatre après midy,par devant les notaires royaux à Angers soussignés furent présents les révérends prieur religieux et couvent de l'abbaye de Saint Nicollas les Angers, ordre de Saint Benoist, congrégation de Saint Maur en personnes des soussignés assemblés en leur chapitre au son de la cloche en la manière accoutumée, lesquels ont par ces présentes donné et donnent à titre de ferme à René Richou, laboureur, René Richou son fils aussy laboureur demeurant en l'isle de Behuard parroisse de Denée, à ce présents et acceptants sollidairement sous les renonciations de droit à ce requises pour le tems et espace de sept années et sept ceüillettes entières et consécutives qui commenceront à la feste de Toussaint mil sept cent cinquante-six et finiront à pareil jour savoir les terres labourables et prés situés en la dite isle de Behuard, appartenant aux dits sieurs relligieux avec les arbres saules et luisettes (osiers) qui en dépendent, le droit de pêche dans la rivière de Loire et érage sur la rivière, aux batteaux vis a vis les terres et hérittages.
Telles que les dittes choses se poursuivent et comportent qu'en jouissent depuis longtemps les nommés Etienne Leduc et Mathurin Le Doyen en vertu du bail et prolongation d'icelluy passés devant nous, Portier, l'un des dits notaires, le cinq avril mil sept cent trente-deux, vingt un mars mil sept cent cinquante, sans par mes dits sieurs religieux en faire de réserve, et la charge par les dits preneurs qui ont dit bien connoistre les dittes choses d'enfouir et user en bon père de famille sans malversation, de tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail les terres prés et hayes en dependant en bon état de réparations et de luisettes qui sont dans les chantiers (rives de la Loire) et autres, à quoy fermier de pareilles choses sont ordinairement obligés, lesquelles réparations les dits preneurs recevront des dits Leduc et Doyen, fermiers actuels des dittes choses qui en sont tenus à l'effet de quoy, même pour ce qui regarde les dégradations et malversations commises mesdits sieurs relligieux ont mis et subrogé lesdits preneurs en leurs droits et hipotèques résultant dudit bail et prolongation, desquels lesdits preneurs s'obligent d'exécuter les charges et conditions sy aucunes y sont erronées.
Ce présent bail fait en outre et moyennant la somme de cent soixante livres que lesdits preneurs promettent et s'obligent sollidairement comme dit" est de paier chacun an auxdits sieurs relligieux, entre les mains du révérend père cellerier (économe) en charge de la dicte abbaye à deux termes et payements égaux de Pacques et Toussaint par moitié, premier payement montant à quatre-vingt livres commençant à la feste de Pacques de l'année mil sept cent cinquante-sept, le second montant à pareille somme à la feste de Toussaint suivante et ainsi continuer d'année en année jusqu'à la fin du présent bail, que lesdits preneurs ne pouront cedder ny transporter à autres sans l'exprès consentement desdits sieurs relligieux auxquels ils fourniront grosse (acte notarié) des présentes toutefois et quantes (toujours)".
Convenu entre les dictes parties que les preneurs seront déchargés des trois plats de poisson mentionné cru sur ce bail du vingt un mars mil sept cent cinquante à la charge par eux de payer ainsi qu'ils sy obligent sollidairement comme dit est auxdits frères relligieux et dans la première année du présent bail, la somme de soixante livres à une fois payer, s'obligent en outre lesdits preneurs de fournir chacun an du présent bail quatre quinteaux de foin rendus en la maison de la Roche-aux-Moines et ce dans le cours des vendanges, car ainsi les parties ont le tout voulu consenti, stipulé, etc.....
- Le régime d'exploitation contracté est le fermage à prix d'argent, forme déjà dominante à l'époque. Les petites tenures paysannes étaient soit en fermage, soit en faire-valoir direct. La hiérarchie paysanne était fondée, non sur la propriété mais, sur l'importance de l'exploitation.
- Le laboureur possédait au moins un attelage de labour. Il était propriétaire de son cheptel et de son matériel.
- Le fermier cultive la terre des nobles, des évêques, de bourgeois, il verse un loyer, le fermage. Le métayer donne une part en récolte. Le closier fait valoir une petite exploitation où il n'y a pas de bœufs. Le domestique ne possède rien, il est payé à gages, sa vie est rude ; l'ouvrier agricole (brassier ou manouvrier) se loue à la journée pour les grands travaux, la garde des troupeaux, pendant la morte-saison, il vit de mendicité.
- Les paysans supportent de lourdes charges : ils paient des impôts au roi, au clergé, au seigneur. Ainsi, ils ne conservent que le quart ou le cinquième du produit de leur travail, encore fallait-il que l'année soit bonne.
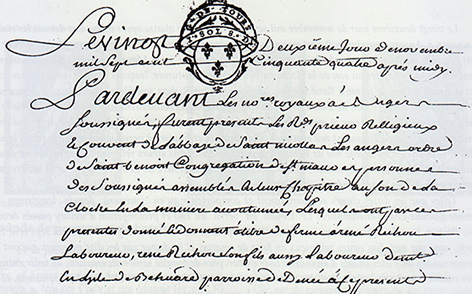
L'île est à la merci de la Loire. Capricieuse, celle-ci vient, se retire à son gré, règle les semailles, la fenaison, les récoltes et assez souvent s'est amusée à noyer le blé et le seigle verts, les foins coupés, les lins et les chanvres hauts. Puis, elle s'esquive, glisse paresseusement le long des rives et donne à Behuard son aspect le plus riant, son aspect de campagne heureuse et paisible.
(source:Revue des Coteaux de Loire et de Maine)
![]()
Le chanvre dans l'île
Termes appropriés à connaitre
- Le chanvrier ou la chanvrière est la personne qui travaille le chanvre, chanvrière peut aussi désigner une coopérative de producteurs de chanvre.
- La chènevière, ou « canebière » dans le Sud de la France, désigne un champ de chanvre.
- Le chènevis désigne la graine de chanvre.
- La chènevotte est la partie ligneuse de la tige, la moelle interne qui reste quand on en a séparé la fibre.
- Un ferrandier est un peigneur de chanvre.
Culture et Récolte
Origine
Le chanvre a ses origines lointaines en Asie mineure. Sa fibre est issue d'une sous-espèce du chanvre, le cannabis sativa, une fibre corticale cellulosique longue. En France, cette plante est connue depuis les confins du Moyen âge. Elle est travaillée dans les campagnes pour les besoins de l'agriculture et partout ailleurs où les cordages sont nécessaires, que ce soit pour les besoins de la marine ou pour de multiples autres usages. D'autre part la proximité du fleuve favorise cette culture pour laquelle le besoin d'eau est primordial.
Déjà, au Moyen-Age, on cultivait le chanvre dans notre Anjou et durant des siècles, occupant des longues soirées d'hiver près du feu ou bien encore, sur le pas de leurs portes par jours de soleil, nos aïeules filaient le lin et le chanvre, à la quenouille et au rouet pour le compte de cordiers et de tisserands.
Développement
Qui aujourd'hui, se souvient du rôle important tenu par le chanvre dans notre vie quotidienne et dans la vie économique du pays. Pourtant cette plante fut considérée comme une production essentielle à côté du blé et des fèves et fut, dans le passé, employée quotidiennement pour ses propriétés textiles (la filasse) et son fruit (le chènevis). La filasse et le chènevis et même la chènevotte (le résidu) faisaient partie de la vie courante.
C'est, sans doute, pour rappeler cette culture que figure, dans l'église de Savennières une représentation du martyr de saint Blaise, patron des tisserands et "filasiers".
Pétrie entre les bras du courant de Loire, l'île de Behuard qui renferme la population d'une commune est formée de terrains riches en alluvions, légers et frais, aptes aux cultures les plus exigeantes. Sa gloire jadis, c'était ses chènevières qui donnaient un chanvre particulièrement fin et souple, très résistant. Le chanvre du Val de Loire suffisait à alimenter la très importante Manufacture des Corderies, filatures et tissages d'Angers. (Le Moy, " l'Anjou ", 1924)
La période 1900-1955 est marquée par la culture du chanvre commercialisée par l'usine Bessonneau
Jacques Levron, dans son ouvrage sur Behuard édité en 1954 , décrit ainsi ce site habité par 130 habitants une petite route traverse l'ile, dessert le village et quelques maisons éparpillées à l'écart. Mais il y a surtout des chemins, des sentiers jalonnés de calvaires ou de statues, qui sinuent entre les champs, les saulaies et les luisettes, ces oseraies argentées qui bordent les rives. Une croix s'élève à chaque extrémité de l'ile et en marque les lisières ...
Presque tous sont des agriculteurs et cultivent des plantes potagères, quelques céréales, un peu de vignes et surtout le chanvre, la principale richesse du pays.
Mais si l'agriculture est l'occupation ordinaire des habitants de Behuard, tous pratiquent la pèche à la cordée, ils s'emparent des anguilles, à l'ancrau (nasse), de la perche ou du brochet, au filet, du savoureux saumon ou de l'alose de Loire .
La fermeture des usines Bessonneau marque un tournant dans l'activité agricole. La culture du chanvre est abandonnée. Cette perte de débouché et l'extinction des activités fluviales de la Loire atteignent tous les actifs de l'île. Il ne reste plus aujourd'hui que deux exploitations agricoles alors qu'on comptait encore 18 fermes en 1955.
L'exploitation
Les exploitations de chanvre côtoient souvent le fleuve pour deux raisons. D'une part, les terres alluvionnaires fertiles, d'une composition harmonieuse, permettent d'excellentes récoltes, indispensables pour répondre à la demande du moment. Ces secteurs agricoles nécessitent des qualités de terroirs agronomiques favorables : trop de sable, le chanvre fane par manque d'eau, le sol ne pouvant la retenir, trop d'argile rend l'arrachage difficile. D'autre part ces terrains sont généralement pourvus de zones de pâturages qui permettent un élevage apporteur de fumier, indispensable à la culture du chanvre
L'Anjou s'installe dans le négoce du chanvre et le début de son extension, à l'est dans le val Loire-Authion tient le haut du pavé avec la commune de la Dagonnière en tête de pont. Dans cette région, on transporte par roulage car une partie des corderies artisanales reste locale, facteur qui, en parallèle, donne du travail à domicile aux femmes. La transformation du chanvre en produit fini est traitée localement.
La culture en basse Loire
Le val de la Possonnière prolongé par les plaines alluviales des rives sud de la Loire en direction de Nantes, participe aussi à l'économie de la région avec la culture du chanvre. La Chapelle-Basse-Mer également, bénéficie en cet endroit des « rouissoirs » que sont la Boire d'Anjou et la Pierre-Percée avec leurs eaux calmes mais, malgré tout, renouvelées. En fait tout le long des rives où c'est possible, le chanvre est présent .Les poignées de chanvre qu'ils appellent « serrons » sont mises en radeau dénommé mauches
Culture et traitement du chanvre
Le semis est effectué en mai pour une récolte de la plante ayant lieu de la mi-août à octobre qui est l'époque du chanvre à graine. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le chanvre est arraché à la main puis rassemblé pour en faire des poignées de 20 centimètres de diamètre attachées avec un brin de chanvre en tête et un de seigle en pied. Puis elles sont chargées dans les charrettes puis transportées vers le fleuve en vue du rouissage.
Après la guerre, avec l'arrivée de la mécanisation, la faucheuse facilite le travail en remplaçant l'arrachage manuel.
Le développement économique
L'essor de la culture du chanvre commence au XVII siècle et se développe au XVIII et XIX siècle. Il va de pair avec l'implantation des manufactures qui se prêtent aux besoins des arsenaux autant que de l'industrie. Colbert entreprend de faire une flotte royale forte : l'armement d'un vaisseau de 74 canons nécessite 84 tonnes de cordages en chanvre et autant en voilure.
Le commerce maritime est également en plein essor et le chanvre français sera insuffisant. À une moindre échelle, la batellerie fluviale est aussi en demande, un grand chaland nécessite 2 tonnes de cordage pour son bon fonctionnement. La demande manufacturière est à son apogée dans les années 1830 à 1850. Les marchands angevins ne sont pas en mesure de répondre à l'offre même si la Touraine fournit beaucoup de ce produit. En 1840, partent de Bréhémont, 80 chalands pleins de ces fibres avec des chargements avoisinant les 45 tonnes.
Puis la concurrence étrangère apparaît avec la Russie, la Baltique ou l'Ukraine. En parallèle se présentent les fibres tropicales puis c'est l'arrivée de la motorisation et des câbles métalliques sur les bateaux. De 1870 à 1900, le déclin se poursuit d'une manière irrémédiable.
Le transport du chanvre
La batellerie de Loire intervient dans le marché du chanvre mais sur de courtes distances. Il faut approvisionner Nantes pour ses corderies. La forte demande des arsenaux est prise en charge par les bateaux maritimes.
Source: La loire, des Hommes et des Bateaux
Le Rouissage
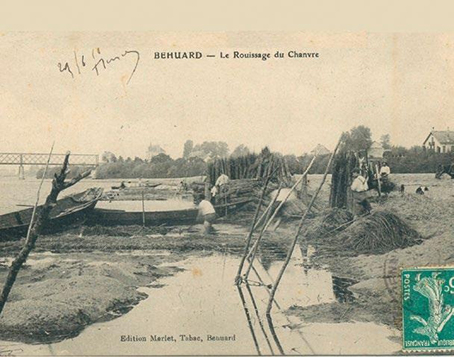
A l'arrière-Plan= le pont sur la Loire, l'ancien restaurant et la propriété du " Merdreau ". Sur la gauche, les barges de chanvre dont on ne voit que la tête parce qu'elles avaient été recouvertes de paille et de sable pour maintenir leur immersion dans l'eau. Des perches sont plantées çà et là pour les stabiliser.
Le rouissage consiste à immerger le chanvre dans l'eau courante, peu profonde, guère plus d'un mètre. Pour cela, on utilise des barges ainsi constituées : on plante deux pieux sur lesquels est fixée horizontalement au fond une perche de cinq à six mètres puis on y pose les poignées de chanvre en les croisant et en les serrant ; après 5 à 6 rangées, on place une autre perche. L'ensemble lié fortement avec des cordes forme alors un radeau. Un lit de paille de seigle mouillée recouvert de sable y est apposé pour permettre une bonne immersion du chanvre qui dure plus ou moins une semaine et nécessite une surveillance journalière afin de bien gérer l'enfoncement. Cette étape oblige la plante à se débarrasser, par dissolution, du ciment peptique qui colmate les fibres. Ce phénomène plus ou moins polluant dû à une manifestation bactériologique a l'inconvénient de dégager des odeurs difficilement supportables. À ce stade, les chanvriers craignent alors la crue qui pourrait emporter tout le travail d'une saison.
Le traitement par rouissage particulièrement polluant, dégrade la faune piscicole. Au XIXe siècle, ces eaux polluées sont considérées comme à risque. Un ensemble d'arrêtés préfectoraux régit alors ces opérations dont ceux du 17 juin 1850, du 26 juillet 1853, du 23 juillet 1855 :
1-Le rouissage n'aura lieu qu'à 30 mètres du chenal navigable, indiqué, en été, par les balises placées soit par l'administration des Ponts et Chaussées, soit par les mariniers.
2-Il sera également défendu de charger le chanvre et le lin avec d'autres matériaux que du sable pur pris sur les grèves. Le sable employé au chargement sera régalé et nivelé, après le rouissage, par les personnes qui en auront fait usage pour cette opération.
3-Il sera également défendu d'employer des pieux et piquets, de quelques espèces que ce soit, pour retenir les amas de chanvre et de lin
Séchage
Les poignées de chanvre sont ensuite positionnées debout avec la mise en tourette pour un égouttage efficace. Le lendemain, le chanvre est transporté sur les prés pour l'étendage et le séchage. En le retournant au bout de deux jours, la filasse blanchit, ce qui est le critère d'une bonne qualité pour un meilleur prix de vente. Si le séchage n'est pas terminé, les brins reconstitués en poignées sont mis debout en « chandeliers ». Ensuite les poignées sont liées en formant des fagots qui seront stockés dans les greniers en attendant le brayage.
Séchage dans un Four à Behuard
Le four à chanvre est une construction qui servait à la dessiccation du chanvre.
L'étape de séchage de l'écorce des tiges et des racines suivait celle du rouissage (pourrissement dans l'eau des parties tendres et conservation de la fibre) et s'effectuait avant le broyage et le peignage de la fibre de chanvre restante.
Effectué autrefois dans un four à pain, le séchage du chanvre s'est ensuite fait dans un bâtiment conçu spécialement à cet effet.
On retrouve ce type de bâti dans les régions où l'on cultivait le chanvre notamment en Sarthe, dans l'Orne, la Mayenne, les Pays de Loire, en Touraine ou encore en Charente
![]()
Architecture
Suivant les régions, les fours à chanvre ont un plan quadrangulaire ou cylindrique, construits en pierre (grès roussard) par exemple ou en brique et sont parfois couverts d'un enduit de sable et de chaux grasse.
Le diamètre moyen du four est de 3 à 4m pour une hauteur de 4 ou 5m.
Dans la Sarthe, les fours ronds sont les plus courants mais il existe également des fours carrés. La chambre du chanvre peut être fermée par un plafond en solives recouvertes de chaux et d'un assemblage de moellons qui s'oppose au départ de chaleur. Le dôme peut être en maçonnerie avec une terrasse pleine, un toit plat ou un toit à deux ou quatre pans. La plupart du temps, le toit sera conique.
En Touraine, où les fours à chanvre sont souvent de plan quadrangulaire, le toit est à deux pans ou en pavillon et recouvre une voûte en pierre construite afin de conserver la chaleur du foyer. Dans le même département, un four à chanvre peut être complété d'un pigeonnier sous le toit.
La toiture déborde du bâti afin de protéger l'enduit et est couverte de tuiles ou d'ardoises. Si elle est rayonnante, elle dispose d'une pente du toit d'à peu près 45°.
Sa poussée peut être compensée par un cercle de fer entourant le mur en partie supérieure parfois complété par un cercle au niveau inférieur. Une collerette de zinc ainsi qu'un épi de faîtage protègent le poinçon du toit qui n'est pas couvert.
Ces bâtiments sont généralement installés sur une déclivité du site avec une porte semi enterrée donnant sur la chambre de chauffe au rez-de-chaussée et au premier niveau, une porte permettant l'accès à la chambre à chanvre.
L'intérieur comporte deux niveaux et est séparé par un plancher à claire-voie ou une grille située à environ 1,60m du sol.
Au rez-de-chaussée, sur un sol dallé, se situe la chambre de chauffe où l'on installait un brasier à coke dans une corbeille en fonte. Le coke ne dégageait pas de flamme mais émettait une forte chaleur qui durait pendant plusieurs heures. Le foyer est construit en briques tout comme les encadrements de portes
Le premier niveau donne sur la chambre à chanvre située au-dessus de la claie et est d'une hauteur moyenne de 2,80 à 3m.
Les fours plus modestes ne disposent que d'une porte permettant à la fois l'ajout de bois dans le foyer et la charge du chanvre sur la grille.
Fonctionnement
Les bottes de chanvre sont enfournées par la porte donnant sur la chambre haute du four puis sont posées sur la claie ou suspendues. La porte basse donne quant à elle sur le foyer où l'on ajoute des fagots ou briquettes de coke que l'on allume. Le chanvre est chauffé pendant une dizaine d'heures, pendant la nuit, à une température de 60°C.
La fumée passait par le plancher puis par les fibres de chanvre avant de s'échapper par la couverture ou, selon les régions, par des lucarnons dans les murs. Dans le Maine, les maçonneries sont la plupart du temps continues alors qu'en Touraine, elles peuvent être percées par des ouvertures à l'étage.
Source=https://wiki.maisons-paysannes.org/wiki/Four-à-chanvre
Le Brayage
Le brayage commence à la mi-novembre et peut s'étaler sur deux ou trois mois. Dans un premier temps, le chanvre est chauffé à l'aide de fours. On emploie de la « chènevotte », résidu du chanvre après le brayage, en tant que combustible. Monté à bonne température, le feu est arrêté et le four nettoyé de ses braises. Le chanvre est alors enfourné et la porte du foyer refermée jusqu'au lendemain. Cette opération se répètera tous les jours pour assurer le travail du lendemain. Le chanvre sera ainsi suffisamment sec pour commencer le brayage.
le brayage consiste à briser la plante, pour en séparer la fibre de l'écorce. Cette pratique se fait à la main jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. L'outil indispensable s'appelle « la braie » un engin monté sur quatre pieds est composé de deux mâchoires. La partie basse 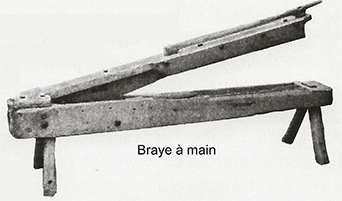
est composée de quatre planches parallèles présentées horizontalement avec les sections verticales biseautées en haut. Au-dessus, la même pièce est composée de seulement trois planches qui viennent s'imbriquer dans celles du bas à l'aide d'une poignée. En faisant avancer les tiges de chanvre, placées en travers dans la machine, tout en cisaillant, celles-ci ressortent brisées sur l'ensemble. La fibre ou fillasse se trouve ainsidépossédée de la chènevotte.
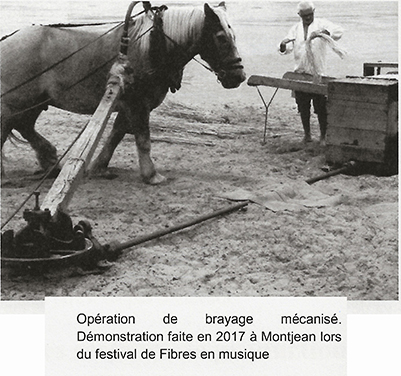
La mécanisation apporte du confort à ce pénible travail. Vers 1905 apparaît la « brayeuse », une machine composée de cylindres cannelés à travers lesquels va passer le végétal. C'est un manège entraîné par un cheval qui apporte l'énergie nécessaire au mécanisme.
Le cardage ou " teillage"

Le cardage ou peignage est le dernier traitement que subit la matière. Le but est de supprimer de la filasse les fibres trop courtes ou étoupes et les brisures encore accrochées. Manuellement, c'est le peigne à carder pointes à chanvre qui est employé. Lorsque l'opération se mécanise, on parle de lissage .
Le produit fini se présente en écheveau ou torche puis est conditionné par 25 kilos que les commissionnaires viendront collecter, prêts à être manufacturés.
Le rendement peut atteindre 6 à 8 tonnes par hectare, pour fournir, au terme de son traitement, 1,80 t à 2,40 t de filasse sèche et peignée.
Marie-Louise Boussard de Behuard raconte:
La récolte du chanvre
Témoin de la vie agricole à Behuard en cette première moitié de siècle, Mme Marie-Louise Boussard se mariait en 1930 avec Joseph Boussard dont les parents étaient originaires de Behuard. Ensemble ils ont exploité jusqu'en 1977, en cette même commune, la ferme du " Bas-Griveau " située en queue d'île.
Mme Boussard a fêté ses 91 ans et toujours alerte, vive d'esprit et chaleureuse vit aujourd'hui à Savennières. Elle se souvient des durs travaux des champs avec l'aide des chevaux et en particulier de ceux qui ont trait à la culture du chanvre.
(M.C. questionneur)
M.C. Avant la dernière guerre, la culture du chanvre était dit-on, répandue sur l'île ?
M.L.B. Le chanvre était la culture principale pour tout le monde ; à l'époque, il y avait encore une quinzaine de fermes : Roger Réthoré, Pierre Richou au Haut-Griveau, René Richou, Rousseau, Cady, tonton René Boussard, Jean Besnard, René Tonnay, Henri Tonnay, Léon Voisine qui habitait à côté de chez nous, Cyprien Lefevre à la ferme du Bois. A ce jour, il n'en reste plus que deux : le " Bas-Griveau " et " le Bois ". On cultivait aussi un peu de blé, du seigle, et aussi des choux et des betteraves pour nourrir les animaux l'hiver : quelques vaches et quelques jeunesses (veaux et génisses).
M.C. Du chanvre on tire la filasse et le chènevis. A quels usages étaient destinées les filasses ?
M.L.B. Aux usines Bessonneau. Avec les rachures on faisait quelques cordes et de l'étoupe. On ne récoltait qu'une petite quantité de chènevis réservée à des semis précoces. Les cordages agricoles, on les achetait, une douzaine chaque fois, chez Bessonneau, qui nous faisait un prix.
Léon Voisine cultivait, lui-aussi, du chanvre sur l'île, près de chez nous et il était, en même temps, le démarcheur des usines Bessonneau pour l'île.
Il passait dans les fermes, évaluait la qualité de la filasse et fixait le prix du lot. On ne marchandait même pas. Léon Voisine était connaisseur et connu de tout le monde ; on lui faisait confiance. Il y avait aussi Pierre Thuleau de Chalonnes pour les usines Saint Frères. Trois fois par an, nous passions à Savennières pour faire peser sur la bascule qui existait derrière l'église et nous allions ensuite livrer à la gare des Forges. Les démarcheurs étaient présents. Quand les affaires étaient terminées, ils s'offraient un " beurre blanc " au café Cady des Forges en compagnie des acheteurs et nous, on buvait un verre de vin blanc avant de rentrer à la maison.
M. C. Avec l'apparition des fibres chimiques, les cultivateurs abandonnent cette culture
M.L.B Les prix baissaient. Vers les années 1960, je crois, tout le monde s'est mis dans les cultures de graines (pensées, reines-marguerites), les bulbes, surtout les glaïeuls, que nous vendions à une graineterie de la rue des Lices. La fermeture des usines Bessonneau nous a beaucoup ennuyés : le chanvre c'était dur mais on savait ce qu'on faisait, c'était sûr et on était habitué, les graines c'était aléatoire.
M.C. Dans certaines régions, il était de règle de faire alterner les fèves (ou les céréales) avec les chanvres dans l'assolement biennal.
M.L.B. On alternait un peu avec le blé, mais on craignait les crues. Le chanvre est une plante exigeante, il ne fallait pas semer deux fois de suite au même endroit ; en plus, des alluvions, nous engraissions la terre avec notre fumier d'étable.
M.C. Les communes situées sur les bords de l'Authion étaient réputées dans toute la France pour produire les meilleurs chènevis. La semence provenait-elle de cet endroit ?
M.L.B. Je ne me souviens pas où nous achetions la semence, mais elle donnait de beaux chanvres, comme dans l'île de Chalonnes. Bien sûr, il y avait des années meilleures les unes que les autres. Nous semions début mai, après les derniers risques d'inondation, à l'aide d'une rayonneuse (semoir) tirée par un cheval sur une largeur de soixante centimètres. Certaines années les inondations tardives nous mettaient en retard. Le rendement était alors moins bon et la filasse moins belle. La hauteur de la plante variait selon les années, ça dépendait du temps qu'il faisait. Ce qui était à craindre le plus, c'était la grêle : elle cassait le brin arrêtant du même coup sa végétation et c'était quasi impossible de le redresser.
M.C. Avez-vous participer aux travaux d'arrachage à la main ?
M.L.B. Jusqu'en 1940, l'arrachage se faisait à la main à partir de la fin août. Je portais des gants et malgré tout j'attrapais quand même des ampoules, c'était horrible. En 1939, mon mari fut appelé à la guerre. Avec mon beau-père nous faisions seuls le travail.
En 1940, le sol était si sec que j'en ai eu trop marre, alors j'ai pris une faucille pour le couper, Cela perdait dans le rendement parce que le brin était moins long. L'idée nous est venue d'utiliser la faucheuse. Et après, dans le village, tout le monde s'est mis à faire comme nous. Ce fut vraiment ensuite plus facile. Les brins étaient rassemblés en bottes avec deux liens de paille de seigle puis transportés par charretées au Haut-Griveau au bord de la Loire. Le chemin de traverse était souvent en mauvais état avec des ornières profondes. J'ai vu plusieurs fois tout le dessus de la charretée s'ébouler par terre.
M.C. Sitôt le chanvre arraché, il faut le faire rouir. Deviez-vous payer un droit de rouissage ou respecter quelque réglementation légale ?
M.L.B. Personne ne payait quoi que ce soit, tous les ans ça se passait de la même façon, chacun avait son coin. On montait des barges. A Behuard, les bottes étaient ligotées entre elles, en croix, avec des brins d'osier alors qu'à Champtocé ça se faisait avec de la ficelle de chanvre. Sur le tas, il était mis de la paille et encore du sable par-dessus car il fallait que le chanvre soit parfaitement immergé. Ce n'était pas non plus de tout repos ; je me souviens qu'on allait dans l'eau, les pieds nus, les jupes retroussées car on en avait jusqu'au-dessus des genoux, Ça arrivait de tomber dans l'eau. Il y avait parfois des inondations subites ; une année, il y a eu de la crue, tout le tas était parti. Avec la charte (charrette) nous sommes allés jusqu'à Montjean pour les récupérer. Quel travail ! Et cela de plus que ça sentait le coui, une infection !
Par contre, les pêcheurs qui se plaignaient pourtant de la puanteur, ils venaient se placer sur les barges au risque de provoquer leur enfouissement dans la vase, tout cela parce qu'il y avait plein de poissons alentour. Après une semaine environ, on tirait les bottes de l'eau. Il fallait un peu les nettoyer de leur pourriture. C'était lourd et ça sentait mauvais. On les mettait debout pour l'égouttage, en tourelles d'une douzaine, sur le pré (sur la grève, du côté de la tête d'île). Puis on les faisait sécher en étalant les brins sur le sol ; après trois jours, il fallait les retourner avec une balise (perche de saule) pour faire sécher également le deuxième côté. C'était plus facile quand il n'y avait pas de vent. La belle rosée ou le bon brouillard du matin rendait le chanvre plus blanc. Plus il était blanc, plus il avait de qualité. Une fois sec, il fallait le remettre en tourelles en attendant de le charroyer.
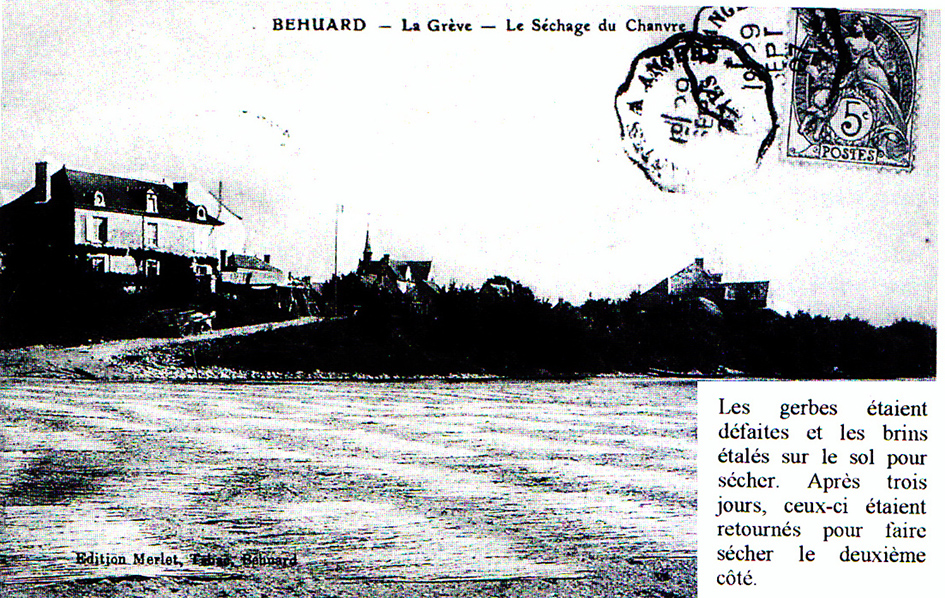
M.C. Où entreposiez-vous la récolte ?
ML.B. On la mettait dans un grenier où elle attendait jusqu'à novembre. Remisé bien sec, le chanvre ne s 'abîmait pas mais les souris, elles aimaient bien y faire leurs nids.
M.C. Pour obtenir la filasse, il faut faire tomber la chènevotte. De quel matériel disposiez-vous pour broyer et lisser ?
M.L.B. Le breyage est un travail d'hiver, on commençait début novembre. Cela se passait dans la breillerie, un bâtiment qui contenait tout le matériel. Tous les jours le four était chauffé en allumant des déchets. Je vidais le foyer de ses cendres chaudes et brindilles restantes en passant une nippe (une perche avec en bout un gros chiffon humide). Des fois, le feu prenait dans le four parce qu'il restait quelques brindilles et de la poussière, hé bien, toute la fournée était perdue ; des fois aussi, le chanvre roussissait un peu trop et alors la filasse trop colorée s'en allait en rachures.
Il fallait se lever à deux heures du matin pour breyer et ça durait jusqu'à l'heure de tirer les vaches vers sept heures. Le travail se faisait à trois : mon mari transportait les bottes, moi qui mettait les bottes dans la breyeuse et mon beau-père qui recevait la filasse au " cul " de la machine et la déposait sur un tréteau. C'était mon mari qui s'occupait aussi de lisser les poignées avec une machine qui tournait très vite, ça nettoyait la filasse de ses dernières saletés.
Nous avions aussi un manège qui se trouvait dehors dans un rond-point. Notre cheval était attelé au manège et tournait en rond, il marchait bien mais il y avait des chevaux qui n'aimaient pas ça du tout. Ça faisait fonctionner une breyeuse. Le chanvre était jeté sur la machine. Les guertes (débris) se retrouvaient par terre. Chaque jour nous en faisions un petit tas que nous remisions dans un coin en attendant d'allumer le four le lendemain matin.
M.C. Quels soins apportiez-vous à la fabrication des écheveaux ?
M.L.B. Je pliais les poignées en deux et je les nouais en torches. J'essayais de lisser la pomme le mieux possible pour la rendre plus jolie dans les balles de chanvre. Il fallait donner une belle apparence : en un coup d'œil le démarcheur évaluait la longueur, la couleur, la finesse, la solidité du brin et aussi la netteté, l'esthétique de la balle (25 paquets de 25 poignées).
M.C. Plus de filasse, plus d'écheveaux, plus de chevaux, est-ce qu'au moins le four à chanvre a été conservé à la ferme du " Bas-Griveau " ?
M.L.B. Non, il a été démoli. Il doit encore y en avoir un chez Pierre Richou au Haut-Griveau et chez René Richou dans le bourg.
M.C. Si vous deviez revivre ces moments de votre passé le feriez-vous avec plaisir?
M.L.B. C'était dur : Les travaux de culture avaient lieu dans les jours les plus chauds de l'année. Tout était pénible pour le corps : la rugosité du brin, l'arrachage, le rouissage, le breyage, la surveillance du four, se lever à deux heures le matin pour aller breyer. Mais... c'était notre vie. Lorsque les années étaient bonnes, nous étions fiers de nos cultures, de la qualité de notre filasse. Le jour de la livraison nous étions contents d'avoir accompli un beau travail et de voir rentrer de l'argent. Nos fatigues étaient oubliées, nous pensions déjà aux prochaines semailles.
Sources :histoire des Coteaux de la Loire et du Maine
![]()
LES PASSEURS
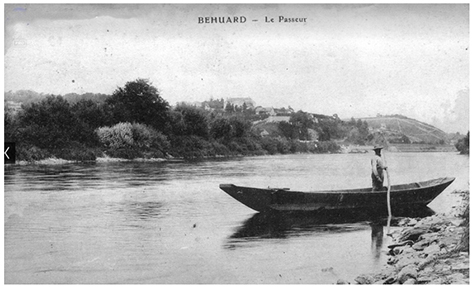
Behuard est aujourd'hui une des plus petites communes du Maine-et-Loire, avec 230 hectares et 110 habitants. Le Port du Bois, face au hameau des Forges, a toujours été la porte d'entrée du village avant la construction du pont en 1880. Il précise : « Les pèlerins avant cette date arrivaient de ce côté-là, par les chemins de Savennières puis par le chemin de fer jusqu'à la gare des Forges». Les passeurs attendaient là, afin de leur faire franchir le bras de la Guillemette. De nos jours, le pèlerinage se déroule en septembre, couvrant l'île, chaque année de milliers de visiteurs.

Le rôle des passeurs
Il ne se limite pas à l'événement annuel. D'autres visites, plus impromptues, mobilisent les bateliers. L'île est inondable. Les jours de crue, pour rejoindre la terre ferme, les habitants sortent leurs bateaux. De l'avis de Bruno Richou, on ne peut habiter Behuard sans accepter les inondations et ses contraintes. Quand le village devient une «Venise ligérienne », une curieuse animation retentit dans les rues canalisées. Les passeurs d'aujourd'hui, s'en vont de maison en maison. Le maire et un collègue assurent la distribution du courrier et veillent à ce que personne ne soit isolé. Tous les matins, les navettes, pour rejoindre Savennières, sont nombreuses. Chacun doit se rendre au travail. Monsieur le maire conclut : «C'est bien qu'il y ait des inondations, les problèmes de voisinage s'oublient vite. Le maître mot à Behuard est «solidarité» car l'entraide est une nécessité.
Une autre manifestation entretient les pratiques batelières des habitants : la fête de la plate, qui comptera bientôt deux décennies d'existence. L'événement bien connu des Ligériens a toujours lieu le dernier week-end du mois de septembre. Il consiste en courses de bateaux traditionnels, en équipage de deux rameurs, en distinguant enfants, femmes et hommes. Lors de sa création, la fête visait à faire revivre une tradition locale, celle des rencontres sur l'eau des villages voisins de Denée, Rochefort et Behuard. L'objectif semble atteint : 6000 visiteurs sont attendus chaque année, pour un programme classique de courses de bateaux et de dégustation de friture, sur fond de marché artisanal. Ainsi chaque année le bras de la Guillemette, investi de plates et de futreaux, fait surgir l'image d'une Loire ressuscitée et ce n'est pas pour déplaire aux héritiers des passeurs.
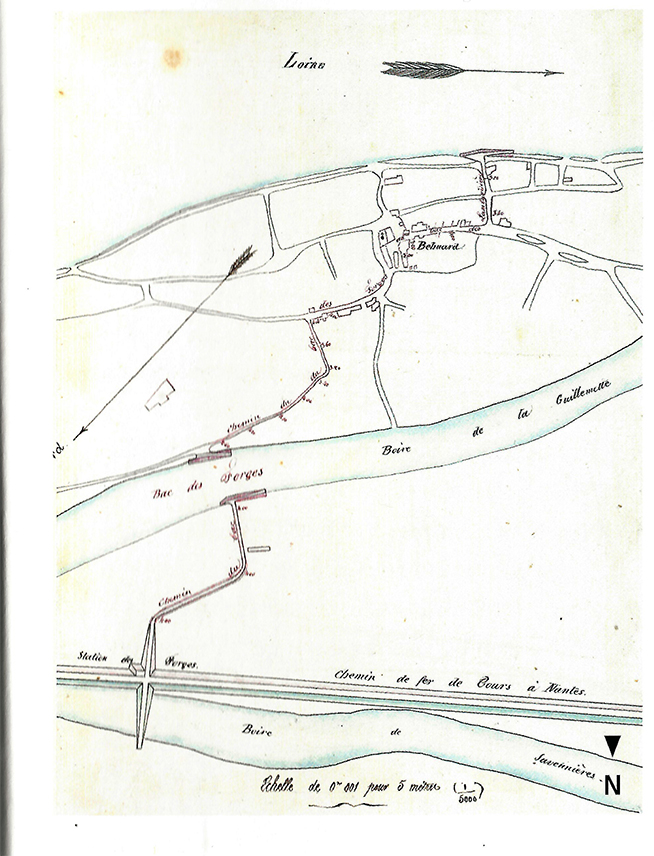 Notre connaissance des anciens passeurs s'appuie, comme pour les autres sites, sur les archives du service des bacs et passages d'eau du Maine-et-Loire. Pour ce secteur, il est fait mention du bac des Forges ,attaché à la commune de Savennières, et parfois du bac de l'île du Bois qui est évidemment le même .Le Bois est un hameau de Behuard où abordent les bateaux du passage .Une pétition des habitants adressée au préfet donne un plan annexé, le tracé exact du chemin du bac. Ce site de franchissement est évidemment un des plus complexes de la basse Loire, exigeant plusieurs traversées, celle du bras de la Guillemette, du bras des Lombardières, puis selon l'itinéraire, du bras du Port Godard ou de Mantelon. Les passeurs de rivière sont ainsi les guides indispensables, possédant une parfaite connaissance de leur portion de fleuve.
Notre connaissance des anciens passeurs s'appuie, comme pour les autres sites, sur les archives du service des bacs et passages d'eau du Maine-et-Loire. Pour ce secteur, il est fait mention du bac des Forges ,attaché à la commune de Savennières, et parfois du bac de l'île du Bois qui est évidemment le même .Le Bois est un hameau de Behuard où abordent les bateaux du passage .Une pétition des habitants adressée au préfet donne un plan annexé, le tracé exact du chemin du bac. Ce site de franchissement est évidemment un des plus complexes de la basse Loire, exigeant plusieurs traversées, celle du bras de la Guillemette, du bras des Lombardières, puis selon l'itinéraire, du bras du Port Godard ou de Mantelon. Les passeurs de rivière sont ainsi les guides indispensables, possédant une parfaite connaissance de leur portion de fleuve.
Un savoir qu'ils se transmettent de génération en génération..
Le fait se vérifie aux Forges où se distingue la famille Boussard, de Behuard. En 1832, René Boussard est titulaire du bac, sa veuve lui succède en 1838.
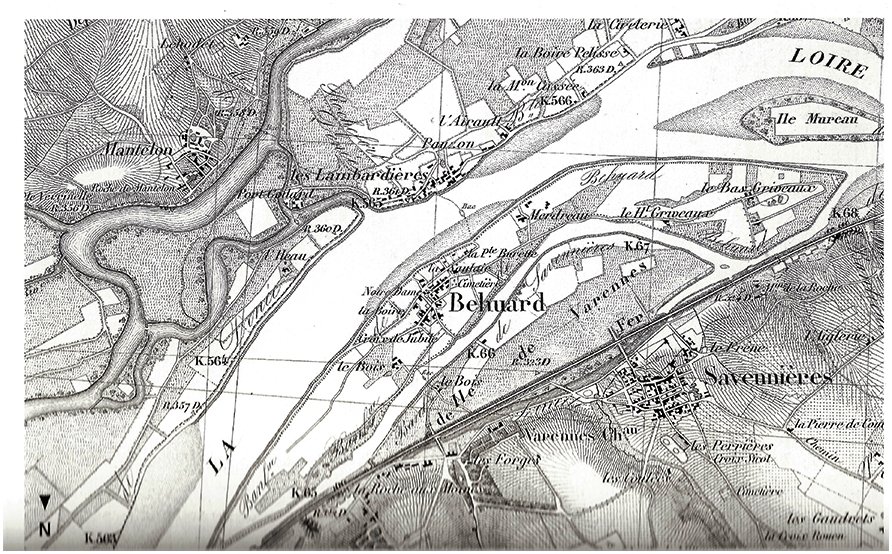
On retrouve cette lignée de passeurs en 1850 avec Pierre Boussard. Lorsqu'on évoque ce nom encore aujourd'hui, on vous donne l'adresse de Gilbert Boussard. Celui-ci réside en queue de l'île et vous accueille chaleureusement. Que ses ancêtres lointains aient été passeurs, ne l'étonne pas ! Il est une tradition familiale d'aller sur l'eau. Lui-même a été facteur intérimaire pendant cinq ou six crues. Son père, Joseph, avait pris la relève de Pierre Boussard, le cousin, passeur aux Forges, le pont ayant été détruit pendant la guerre. Il sait d'ailleurs que les Boussard sont arrivés à Behuard, par la Loire, il y a plus de deux siècles. Ses ancêtres, employés au service de la navigation, étaient originaires de Ménéac en Ille-et-Vilaine. Ils se déplaçaient le long des rivières. Dans les archives, il est aussi question des Rousseau.
L'un est passeur de 1844 à 1849, un autre, en 1906, est pêcheur et sollicite le rétablissement du bac à son profit. Malgré l'existence du pont de la Guillemette, beaucoup d'Angevins, propriétaires d'une maison secondaire sur l'île, gardent l'habitude de traverser aux Forges. Ils y voient un gain de temps. Les pêcheurs locaux se font alors concurrence pour passer les citadins
Passage des Lombardières en 1854Le bateau s'avère un moyen indispensable à la vie quotidienne sur l'île de Behuard. Nous en découvrons un aspect dans cette enquête de la préfecture du Maine-et-Loire de 1906. Il est question d'installer un bac à traille entre Behuard et l'île Mureau. Cette dernière, simple îlot, est traditionnellement cultivée. Les propriétaires y abordent en bateau sur chaque parcelle en l'absence de chemin. On y vient retirer les récoltes de blé, de chanvre et de raisins.
Or trois ouvrages installés dans le cadre de la Loire navigable en limitent l'accès. La solution du bac n'est cependant pas adoptée. L'isolement du Mureau n'est rompu qu'en 1948 avec la construction d'une chaussée.
La fonction de passeur n'est en rien réservée aux habitants de Behuard.
De l'autre côté du Grand Bras, il y a les bateliers valléiais. Le bac des Lombardières leur est échu. Le personnage qui s'est longtemps imposé en ce lieu est une femme, Louise Dolbeau, qui conserve son bail dix-huit années consécutives. Elle obtient le premier affermage en 1832, s'associe en 1838 à Pierre Charbonnier, son mari et, devenue veuve, prolonge le service après 1844. C'est Jacques Thonay qui lui succède en 1850. La plate-forme du port du bac est réaménagée en 1881. La forte activité fluviale de ce secteur a profondément marqué le quartier. Celui-ci est lieu de résidence des mariniers et des pêcheurs. La maison de la Lombarde, toujours visible, date du XVIe siècle, sa porte est surmontée d'une ancre de marine

À quelques centaines de mètres des Lombardières, Port-Godard est un autre hameau de mariniers, situé sur un des bras du Louet. Un bac permet de rejoindre la queue del'ilede Saint-Jean-de-la-Croix. Au début XIXe siècle, l'état indemnise les passeurs Cordon et Chesnay dont les bateaux sont récupérés pour le service du passage. Les pontonniers sont successivement François Gautier de 1832 à 1843, Chamaillé de 1844 à 1849 et Alexis Rideau, l'ancien passeur de Port-Thibault et habitant de Saint-Jean-de- la-Croix, de 1850 à 1855.Le passage,de Mantelon permet de franchir le second bras du Louet, le plus large, afin de rejoindre la rive gauche. Les passeurs sont tour à tour Pierre Doussard, en 1832, Jean Papin dit Dendrau, en 1838, Joubert et Bonnaire, en 1844, Charles Binet, en 1850.
En 1856, la veuve de Jean Papin, propriétaire résidant à Denée, cède à l'état un terrain pour la construction de la cale de Mantelon. On en déduit qu'avant cette date l'abord du passage d'eau est une simple grève .Les bateaux utilisés dans ce secteur sont généralement des futreaux. Ils servent au transport du chanvre que l'on met à rouir dans la boire des jardins ,sorte de canal rejoignant les deux bras du Louet. Quelques toues (bateaux)circulent encore sur le Louet au début du XXe siècle Elles appartiennent aux agriculteurs de l'Îlot afin d'évacuer, en temps de crue, leur bétail vers le village de Mantelon. Alain Mareau, des Jubeaux, se rappelle bien les avoir vues dans sa jeunesse.
![]()
Batelier Passeur
Dans le monde des vivants, le passeur est un homme indispensable. À ce maître de son élément, on confie sa vie. Il est un être à part, un homme de caractère. Héritiers de cette identité particulière, les passeurs d'aujourd'hui semblent témoigner de cette filiation.
Baignés dans l'art de la navigation, ils s'élèvent au-dessus du quidam et se forgent de forts tempéraments. Nous citionsGilbert Boussard dans l'histoire fluviale de Behuard et pour cause, l'homme est en ce lieu, incontournable. Il nous fallait le rencontrer.
Batelier de Behuard
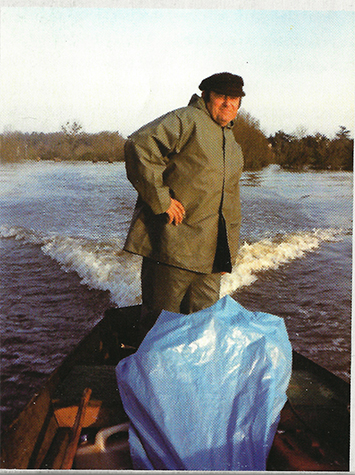 Gilbert Boussard habite au Bas Grivaux, en queue de l'île de Behuard. Ses parents étaient agriculteurs. Lui ne s'est pas tout de suite installé. Il a été, tour à tour, docker à Angers, employé des chemins de fer, postier et, finalement, est revenu à ses racines. Sur l'île natale, il a repris dix-sept petites exploitations autour de Behuard et s'est constitué un patrimoine de 105 hectares. Il produisait du maïs, du tournesol, de l'orge de brasserie et deux à trois jours par semaine devenait bûcheron. Si l'heure de la retraite a sonné, Gilbert ne pantoufle pas pour autant. Chasseur, pêcheur de lamproies, il est avant tout batelier de Behuard.
Gilbert Boussard habite au Bas Grivaux, en queue de l'île de Behuard. Ses parents étaient agriculteurs. Lui ne s'est pas tout de suite installé. Il a été, tour à tour, docker à Angers, employé des chemins de fer, postier et, finalement, est revenu à ses racines. Sur l'île natale, il a repris dix-sept petites exploitations autour de Behuard et s'est constitué un patrimoine de 105 hectares. Il produisait du maïs, du tournesol, de l'orge de brasserie et deux à trois jours par semaine devenait bûcheron. Si l'heure de la retraite a sonné, Gilbert ne pantoufle pas pour autant. Chasseur, pêcheur de lamproies, il est avant tout batelier de Behuard.
«J'ai eu six bateaux jusqu'à présent. Certains ont été faits par le père Brault à Rochefort, dans la vallée .J'en ai eu deux qui ont été construits chez mon grand-père à Saint-Germain-des-Prés. Il était charpentier de marine. Les bateaux, bah ! dame, s'en sont allés, usés, parce qu'ils servaient pour charrier le fumier quand il y avait des crues, ou pour le bois. On le coupait et on le mettait en tas dans un endroit assez haut. Avec la crue, on le ramenait à la maison. Pour le fumier, on mettait un entourage de piquets autour du bateau pour le rehausser. Il était toujours emmené dans les champs quand l'eau était haute. J'ai vu revenir de l'île Mureau avec trois centimètres de bord et puis on n'a jamais été au fond, on aurait dû y aller. Certaines fois, je mettais deux grands futreaux de chaque côté du petit bateau pour charrier tout ce qu'il y avait à prendre. Après on a eu des bateaux plus légers parce qu'on en avait moins besoin.
Le dernier bateau que j'ai eu en bois, c'était un bateau en cèdre ; il venait de la Vienne, il était léger, ça filait bien mais on a été obligé de changer.
Avec la motogodille ça allait, mais, avec les propulseurs, c'était trop léger. Alors j'en ai acheté un en tôle .
Transmettre l'art de naviguer
«J'ai appris à faire du bateau sur une "néyette", un bateau en sapin, 3 mètres de long, 25 centimètres de bord, ça servait dans le temps pour aller à la chasse aux canards. Mon gars et ma fille ont aussi commencé là-dessus. Ils ont appris à tirer sur la rame, à prendre la perche. De toute façon, on a été au fond avec, je ne sais pas combien de fois. J'ai vu aller à la chasse dans l'île Mureau, deux paniers de cannes, les fusils et deux bonhommes dedans et bien c'était trop. Ne fallait pas bouger beaucoup. Quand on revenait à terre, en voulant descendre, paf, tout le monde allait à l'eau.Ici, on avait surtout des futreaux, des grands bateaux de 7 mètres. C'est un bateau de travail et on avait un autre plus petit qui servait à aller à Savennières en temps de crue, à la rame. Il était plus léger, moins long, 5,50 mètres. Moi, il m'a servi quand j'ai commencé l'école, pendant la guerre, parce qu'il n'y avait plus de pont. J'avais dix ans, j'y allais tout seul, je descendais la queue du canal. Quand il y avait des grands-pères dans les familles, c'est eux qui passaient les enfants. Je me souviens du grand-père Cady, il avait 73 ans et passait encore ses deux petits-enfants ».
Le Rôle des Femmes dans la Navigation.
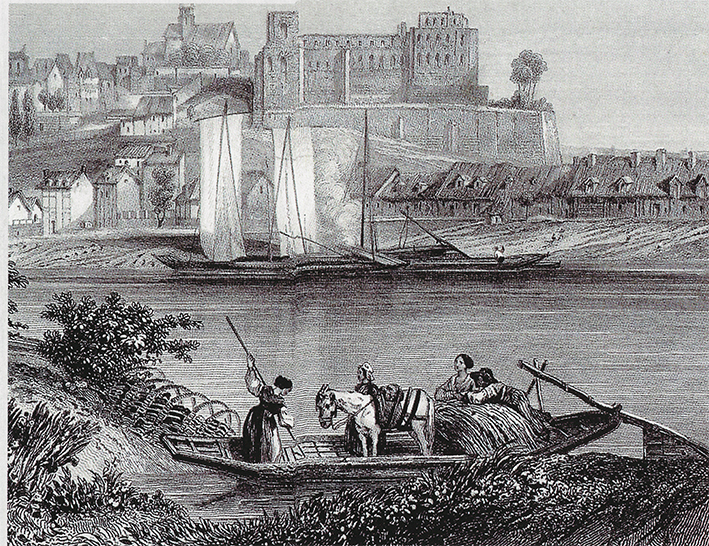
Les courses de bateaux. Celles de Montjean dites «courses de la Saint-Symphorien » étaient célèbres au début du XXe siècle pour ses équipes de rameuses venues de tous les ports ligériens. Celles de Behuard remises à l'honneur en 1990 perpétuent aujourd'hui la tradition.

La « Baillée aux filles »
Ces coutumes singulières permettent d'observer le rôle des femmes dans la navigation. Il n'est pas banal de découvrir dans ce monde dit des « Hommes de la Loire » l'amorce d'une émancipation. Si l'étude reste à faire, les faits que nous citons témoignent d'une ouverture au sein même de la communauté fluviale. Jeanne et Camille Fraysse évoquent cet aspect dans l'ouvrage Vie quotidienne au temps de la marine de Loire. Ils observent que chaque village en bordure de rivière avait un passeur. C'était le plus souvent un ancien marinier mais, à défaut, c'était toujours un riverain ayant une grande expérience et une bonne connaissance des lieux à naviguer.

Equipes féminines dans les courses nautiques
La fonction n'excluait pas les femmes, habitantes des îles, des bords de rivières et des zones inondables. Le couple d'historiens cite à l'appui de nombreux exemples dont celui du décès de Jeanne Queru en 1643. Celle-ci exerce le métier de passeur et se noie en faisant traverser un homme et son cheval au port de la Maison-Neuve, paroisse de Seiches-sur-le-Loir. Nous avons, nous-même, évoqué ce rôle des femmes pour la commune de Soulaire-et-Bourg, enclavée dans la zone de confluence des Trois Rivières, obligeant les villageoises aux pratiques batelières.
Les femmes sont au fait de la navigation tant pour les besoins domestiques que pour assurer le service du passage. Reste à connaître l'ampleur du phénomène : était-il marginal ou généralisé ?
L'inventaire des sites de passages que nous avons établi pour la région comprise entre Nantes et Les Ponts-de-Cé, livre quelques constats.
Sur 154 adjudicataires de bacs répertoriés, 14 (soit 9 %) sont des femmes. Mais le pourcentage est à doubler si l'on se fie aux pratiques réelles, et que les contrats passés avec l'administration ne dévoilent pas. Afin d'assurer la continuité du service, l'épouse du passeur ou sa fille est souvent contrainte à des passages occasionnels. Les femmes sont encore plus sollicitées lorsque les maris sont pécheurs, mariniers ou marins dans le port de Nantes. Les femmes adjudicataires des bacs sont, dans presque tous les cas, des veuves qui ont succédé leur mari. Elles sont pour la plupart résidentes des îles ,celle de Trentemoult près de Nantes, de Behuard, des Lombardières et de la vallée du Louet en général. En ces lieux, on suppose qu'elles pratiquent elles-mêmes le passage, mais qu'elles le délèguent- à quelques mariniers dans les plus grands ports. C'est le cas à Saint-Florent-le-Vieil, à Champtoceaux, à Clermont et à Nantes.
Les services de la navigation fluviale ne s'opposaient pas à la pratique du métier par les femmes et, savaient même reconnaitre leurs mérites. Un rôle indéniable et des talents reconnus.
Source Passeur de Loire par Didier DANIEL
![]()
Le Halage et les Bateaux
Le Halage à Col d'Homme
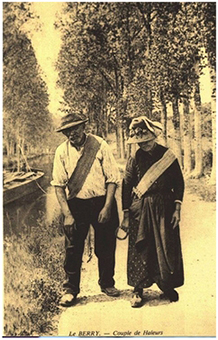 Ils tractaient tête baissée, le regard vide, les épaules labourées par la bande de tissu de la bricole. Ils halaient, les dents serrées sur leur fatigue, gesticulant sans cesse pour tenter de chasser les mouches nombreuses qui voltigeaient sur le chemin de halage..." Arilde Bacon rend ainsi compte de l'effort des hommes qui halent un bateau. De ce travail surhumain ne nous restent que quelques photos et de rares témoignages.
Ils tractaient tête baissée, le regard vide, les épaules labourées par la bande de tissu de la bricole. Ils halaient, les dents serrées sur leur fatigue, gesticulant sans cesse pour tenter de chasser les mouches nombreuses qui voltigeaient sur le chemin de halage..." Arilde Bacon rend ainsi compte de l'effort des hommes qui halent un bateau. De ce travail surhumain ne nous restent que quelques photos et de rares témoignages.
Avant de passer au halage par les chevaux, il fallait nous intéresser au halage à col d'homme.
En premier lieu parce que ce fut probablement une des premières techniques de traction employée sur les voies d'eau. Si quelques auteurs de l'antiquité évoquent bien le halage par des animaux, il n'en reste pas moins vrai que ce travail fut avant tout exécuté par des humains.
Il faut avoir à l'esprit que le halage à col d'homme fut utilisé pendant des siècles et qu'il représente le mode de propulsion le plus longtemps employé en navigation fluviale.
Un peu d'histoire
Particulièrement économique, le halage à col d'homme restera en usage jusqu'à la fin du XIXe siècle, après la réalisation du programme Freycinet (loi du 5 août 1879), qui entraina une mise au gabarit des écluses permettant la navigation de bateaux de 250 à 300 tonnes.Ce type de péniche, déplacé à la vitesse de 700 à 800 mètres par heure par un homme seul, était déplacé à la vitesse d'un peu plus de 2 km/h par une paire de chevaux.
A titre de comparaison, les « berrichons », qui naviguaient sur le canal du Berry, le canal d'Orléans et la Loire, portaient 70 à 80 tonnes pour 28 à 30 m de long. Leur halage était effectué par deux hommes, par des femmes ou même des enfants et souvent par des ânes…
Les berrichons portaient 70 à 80 tonnes en canal . Les tirer était à la portée du halage humain avec des performances comparables à celles de chevaux : un parcours d'une vingtaine de kilomètres par jour.
D'autres critères sont à prendre en compte dans ce choix. Comme le signale René Descombe dans son ouvrage , le halage humain est remarquablement économe en espace sur le bateau, le halage animal nécessitant la présence d'une encombrante écurie sur le bateau.
L'investissement de départ est réduit puisqu'il n'y a pas de chevaux à acheter. Il faut cependant se souvenir que tous les mariniers n'étaient pas propriétaires des chevaux qui les tractaient et qu'il n'y avait pas toujours une écurie sur les péniches tractionnées. Il reste vrai que deux chevaux sont autant de bouches supplémentaires à nourrir.
A l'arrivée, beaucoup considéraient que les frais étaient moindres avec le halage humain, mais le sujet faisait débat.
La mise au gabarit Freycinet va changer la donne. Avec des bateaux portant 300 tonnes, le halage humain ne pourra pas rivaliser avec la traction animale. Encore qu'il convient de noter que certains mariniers recourront encore à la bricole, il est vrai de manière ponctuelle, jusque vers les années 1950.
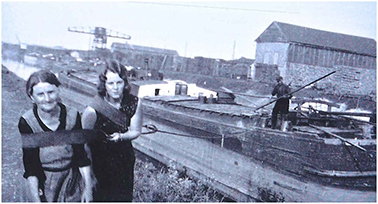
Deux femmes halent un bateau au gabarit important. Le bateau est vide. Le marinier resté à bord éloigne le bateau de la rive pour compenser la traction diagonale. (Source:Image issue du blog La Batellerie).
Penchons-nous un instant sur ces hommes mais aussi ces femmes et ces enfants qui halaient les bateaux.
Cette histoire, comme celle des chevaux de halage, comporte de nombreuses zones d'ombre. A notre connaissance peu d'ouvrages y sont consacrés.
Des témoignages et des informations contradictoires s'entrecroisent. Peut-être parce que certains de ces récits ne situent pas assez le témoignage ni dans le temps ni dans l'espace.
Le halage par les humains est à considérer de manière différente selon les époques et les voies d'eau où il s'exerce.
Les conditions du halage au 15ème siècle ne sont pas celles du 19ème siècle.
Le halage en rivière se démarque du halage sur les canaux.
Chaque région a ses spécificités, ses bateaux. Les canaux du nord ne sont pas ceux du centre, les conditions de navigation qui règnent sur la Loire ne sont pas celles qui régissent la batellerie du Rhône.
Certains haleurs vendaient leur travail à la journée. Ce pouvaient être de pauvres hères qui vivaient près des canaux ou des rivières en espérant trouver un bateau à haler pour un salaire souvent dérisoire. Cette main-d'œuvre se recrutait surtout dans les ports des fleuves et canaux.
François Berenwanger écrit que "Les villes de Fresne-sur-Escaut et de Condé-sur-Escaut disposaient en 1850, de 1500 personnes qui préféraient ce travail pénible à celui de la mine".
Les longs jours, quant à eux, passaient un accord pour la destination finale du convoi.
Ils pouvaient eux même être bateliers et travailler pour une entreprise de batellerie ou pour leur propre compte. D'autres, plus ou moins haleurs occasionnels, exerçaient diverses professions liées ou non à la batellerie (menuisier de marine, paysans).
Mais le recrutement de ces haleurs pouvait être mieux organisé, par exemple au 15ème siècle sur le Rhône, par l'intermédiaire des brochiers. En fait, il s'agissait de marchands de travail qui passaient un contrat avec les patrons-bateliers et les haleurs. Ces derniers, souvent paysans endettés, en difficulté ou débiteurs du brochier, n'en était pas moins des gens dont on exploitait la force de travail.
Dans ce cas les haleurs, étaient encadrés et une assez bonne discipline régnait dans des équipages qui pouvaient se compter par dizaines voire centaines de personnes (quoique ce point soit discutable pour les troupes les plus nombreuses). A la fin du 15ème siècle, ces grandes troupes vont disparaitre assez rapidement au profit de la traction animale.
Le halage à col d'homme subsistera cependant sur le Rhône sous des formes plus modestes.
Il existait en fin de compte beaucoup de configurations différentes.

Pour tirer, les haleurs se passaient ces harnais autour de la poitrine.
Ces bandes de tissus pouvaient être appelées selon les régions, bricoles, las, enses...
Les haleurs tiraient penchés en avant et étaient pour cela surnommés "les ramasseurs de persil". Ils pouvaient aussi tracter en s'arc-boutant sur le dos, alternant les deux positions pour atténuer les douleurs.
salaires des haleurs
Les informations sur les salaires des haleurs à col d'homme sont souvent contradictoires. Salaires de misère pour les uns, bons salaires pour les autres. Là aussi il convient de se situer dans l'époque et le lieu.
Il est difficile de comparer les sommes avancées par les uns et les autres avec le salaires d'aujourd'hui.
François Berewanger indique une somme de 1 franc du kilomètre pour les haleurs qui en 1847, tiraient les bateaux sur l'Escaut belge et la Lys..
Mais nous ne savons pas s'il s'agit de franc belge ou de franc français.
En 1855, MM. Chanoine et De Lagroné indiquent un coût pour le halage à col d'homme sur les canaux du centre de 0.007 franc par kilomètre et par tonne transportée.
Il nous manque trop de renseignements pour évaluer ce que gagnait un haleur:quelle était la taille des bateaux tractés, le tonnage transporté, la fréquence à laquelle les haleurs trouvaient du travail, la longueur des relais ou des voyages etc...
Nous voyons que trop d'éléments nous sont inconnus pour pouvoir réellement juger de ce que représentent ces sommes. On ne peut pas en déduire un salaire, tout juste des frais pour les bateliers.
Nous nous en tiendrons donc à quelques idées générales.
Pourquoi payer un salaire élevé alors que des dizaines, voire des centaines d'hommes attendent d'être embauchés ? Tel était probablement le raisonnement des propriétaires de bateaux là où la main-d'œuvre était abondante, inorganisée et sans qualification.
A contrario, il est possible que dans certaines situations, les haleurs aient pu eux aussi faire subir une certaine pression sur les bateliers. Des documents administratifs belges évoquent vers 1850 une situation conflictuelle dans les rapports entre haleurs et bateliers. Le texte signale de "graves abus auxquels donnent lieu les exigences des corporations de haleurs" sur la Lys et sur l'Escaut .
Dans le Nord, les haleurs essayèrent de se regrouper pour faire valoir leurs droits en 1833. Le préfet d'alors mit fin à cette tentative .
Des documents administratifs français font état, en 1857, de la "désertion" de haleurs du Nord qui quittèrent leur travail de halage pour aller s'embaucher dans les fabriques de sucre et distilleries du pays .
Ce qui laisse supposer que les salaires de ces haleurs ne devaient pas être mirobolants.
En application des dispositions d'un décret de 1875, le halage à la bricole sera cependant interdit par les préfets sur la plupart des canaux.
![]()
Le Halage au Cheval

Avant qu'ils ne soient détrônés par le moteur diésel. Chevaux, mules et ânes « de tirage » (plus rarement des bœufs) ont pendant plusieurs siècles déplacés de lourdes embarcations le long des chemins de halage qui bordent nos voies d'eau.
En France, fleuves et rivières furent en effet appelés à jouer de très bonne heure un rôle considérable dans la vie sociale et économique du pays, où la navigation prit rapidement un essor considérable. Ils se prêtaient en effet admirablement à l'organisation des transports de marchandises, alors que les routes de terre n'existaient qu'à l'état rudimentaire.
De nombreux canaux seront ensuite creusés, unissant entre elles ces voies d'eau pour parfaire le système de navigation ébauché par la nature.
Le mât de halage (en principe utilisé en rivière), fortement haubané, mesure de 2 m à 2,50 m. Il est généralement situé entre le tiers avant et le centre géométrique du bateau.
Les Bateaux à Vapeur
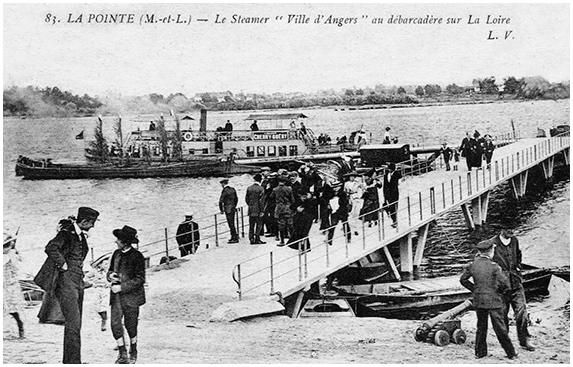
Sur la vieille carte postale , le bateau à vapeur vient de déposer un groupe de passagers sur le débarcadère du village de La Pointe, sur les rives de la Loire. En ce temps-là, durant une bonne période du XIXe siècle, le navire Ville d'Angers fait la liaison fluviale à partir d'Angers jusqu'à l'île de Behuard, avec une escale à La Pointe et à Bouchemaine.
Source:Avenir de l'Ouest avril 1920
La voie de chemin de fer
La population baisse petit à petit, même si la densité bâtie change peu. L'ère industrielle modifie le paysage des abords immédiats de l'ile. L'implantation de la voie de chemin de fer de Nantes à Paris au-dessus du bras de Loire, qui délimitait l'ile de Varennes, introduit un élément nouveau dans le paysage. La station la plus proche se trouve aux Forges . Des embarcadères pour les bacs seront installés à proximité sur les deux rives de la Guillemette.
Les ponts

Puis Behuard est bientôt coupé en deux par un pont routier imposant au-dessus des deux bras de Loire.
Le conseil municipal approuve la décision de construction des ponts permettant de joindre Rochefort et Savennières. Le premier ouvrage, réalisé en 1880 et détruit pendard la Seconde Guerre mondiale, a été reconstruit ultérieurement
Jeux nautiques -Redevances
Coutumes Féodales Redevances
Autrefois, héritées du régime féodal, des lois et coutumes régissaient l'ordre politique et social ; il en découlait des usages qui, de nos jours, ne sont pas sans nous surprendre. Certains dérivaient du fait que le territoire d'une seigneurie était bordé ou traversé par une rivière. Nous allons en signaler quelques-uns concernant la Loire angevine. L'un d'eux était « le droit de Quintaine ».
La quintaine sur l'eau
La Quintaine désignait autrefois un mannequin (ou un écusson) mobile, monté sur un pivot. Le joueur devait, pour le renverser avec la lance (ou la perche) dont il était armé, l'atteindre en son centre. S'il se révélait maladroit, la quintaine tournait sur elle-même. Le fouet ou la verge qu'elle tenait en main frappait alors le jouteur à, la grande joie de l'assistance.
Au cas où la Loire (ou une autre rivière) dépendait du fief, le seigneur stipulait qu'il avait droit de quintaine « tant par terre que par eau ». De ce fait, le poteau de quintaine était souvent dressé dans le lit du fleuve. Pour l'atteindre, il fallait un bateau. Fréquentes étaient alors les baignades forcées, car les compétiteurs n'étaient que par hasard des « hommes de l'eau » habitués à se mouvoir sur l'élément liquide. De tels incidents corsaient le spectacle.
On se rendait en foule à cette fête champêtre, à laquelle, pour la quintaine de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, les tambours de la ville étaient convoqués. Leur présence sur la prairie riveraine devait apporter un surcroît d'intérêt à cette assemblée populaire.
Nous trouvons mention de la dépense faite à cette occasion dans les comptes de l'abbaye : « Aux tambours de la ville venus pour la quintaine, 3 livres ». (Série H, Abbaye Saint-Florent de Saumur, H. 2804, 1758, f. 19 VO ) .
En parcourant les vieux textes de notre province, nous avons relevé le nom d'abbayes et de seigneuries ayant droit de quintaine par eau : le chapitre de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, dont la quintaine pour les paroisses de Saint-Hilaire et de Saint-Barthélémy était plantée dans les eaux du Thouet, et pour le prieuré d'Offard, situé dans une île, face à Saumur, dans la Loire.
A Juigné-sur-Loire, « les nouveaux mariés étaient tenus de tirer la quintaine, « tant par terre que par eau s, le jour de la Trinité .
Il en allait de même pour ceux de Ruzebouc (ancienne appellation du fief de la Pointe), appartenant au chapitre de Saint-Laud d'Angers et de Bouchemaine. A pareille date de l'année, les mêmes redevables masculins « frappaient le « faquin » sur les eaux de la Maine, pendant que leurs épousées offraient chapeau de fleurs, bouquet, baiser et chansons, devant l'église, au prieur de Lévière ou à son sénéchal ».
A l'issue de cette manifestation, un rapport était établi, rappelant le nom des assujettis, les règles du jeu auxquelles ils étaient astreints, les amendes encourues en cas de non comparution ou d'échec, ainsi qu'en témoignent les quelques passages suivants extraits de tels comptes rendus :
« Procès-verbaux du tirage de la quintaine par les nouveaux mariés, dans les paroisses de Saint-Hilaire et de Saint-Barthélémy, au lieudit la Poterne, sur le bord du Thouet, près et au-dessus des moulins de l'abbaye . Les sujets y reçoivent une lance ou baguette et estants ensuitte dans un batteau, qui pour cet effet est préparé par le meunier, doivent tirer droit dans l'escusson qui est posé dans un pau (pieu) planté dans l'eau, et doivent chacun des nouveaux mariés rompre leurs lances ou baguettes, et si les morceaux tombent dans l'eau, ils doivent aller pêcher, le tout à peine d'un escu d'amende, et s'ils ne les rompent du premier coup, ils doivent recommencer jusques à trois fois ; au cas qu'ils frappent l'escusson pour le moins trois fois, ils sont tenus pour exempts... et leurs femmes doivent présenter un bouquet et en le baisant, baiser aussi Monseigneur l'abbé ou son procureur. »
L'usage, interrompu depuis plusieurs années, est rétabli en 1732, le dernier dimanche de mai.
Le procès-verbal suivant, de 1479 , concerne à Saumur le prieuré d'Offard, sis dans l'île du même nom.
« Procès-verbal de la quintaine livrée par les nouveaux mariés de l'année dans le fief du prieuré. Liste des nouveaux mariés ; procédure contre les absents... droit réclamé par le prieur « sur toutes gens lait qui sont nouvellement mariés et qui la première nuyt de leurs nopces couchent et lièvent, ou leurs femmes en son dit fyé et seigneurie dudit prieuré d'Offard, situé et assis sur les pons de ceste ville de Saumur et illec environ, et les contraignant à frapper la quintaine le jour de la Trinité en suivant lesdites nopces, en la rivière de Loire, ou ailleurs en sondit fyé... et sont tenus iceulx nouveaulx mariez eulx comparoir après disner le jour de la Trinité à l'heure qu'ilz sont audiences et au lieu où est plantée et affichée ladite quincqtaine par et en ladite rivière avecque une lance qui leur sera baillée, laquelle s'ilz font déffaut de rompre au dedans des troys coursses, ilz seront constituez en amende envers led. prieur, de LX sols tournois... ou s'ilz ne voulloient ou avoient empeschement d'icelle rompre et courir, lesd. subjectz contraignables sont tenuz d'en faner et composer aud. prieur à son ordonnance au dessoubz de lad. somme de LX sols. »
Sur le Loir, à La Flèche, qui faisait partie de la province d'Anjou, « se courait » autrefois également la quintaine. De sept ans en sept ans seulement y étaient convoqués, non plus les jeunes mariés, mais les bouchers et d'autres artisans :
«... Il y a à La Flèche une ancienne cérémonie qu'on nomme en Bretagne la Quintaine. Le dimanche de la Trinité, de sept ans en sept ans, les bouchers et autres gens de certains métiers sont obligés d'aller en bateau rompre une perche contre un poteau, dans la rivière. Cette cérémonie a dû se faire en 1712 »
Droit de vaulte
L'abbé de Saint-Maur devait verser à la « Comtesse de Beaufort » une somme d'argent quand les inondations amenaient les eaux de la Loire à la hauteur d'un repère, en la circonstance un trou dans la muraille clôturant le domaine sur le bord du fleuve.
En témoigne un accord passé entre les religieux et la « royne de Jhérusalem et de Sicille, comtesse de Beaufort », qui réduit à une seule fois par an le droit de vaulte, c'est-à-dire l'obligation de payer 25 sols, « quand les eaux de la rivière de Loire sont vaux, c'est assavoir quelles montent jusques à un trou estant en la muraille de ladite abbaye... » (18 août 1490).
Corvées par eau
Sous l'ancien régime, l'obligation d'effectuer une ou plusieurs fois l'an des corvées, transports gratuits, figurait au nombre des redevances dues par le vassal à son suzerain, par le fermier au propriétaire de terres exploitées. Les riverains du fleuve étaient ainsi tenus d'assurer un certain nombre de déplacements par eau pour le transport de voyageurs ou de marchandises. La première mention de ce fait, à notre connaissance, remonte en Anjou au XIe siècle . Thibault d'Orléans était alors possesseur du domaine constitué par un côté et la pointe de l'angle formé par le confluent de la Loire et de la Maine (La Pointe). Il y installa des colons, à charge pour ces derniers « de le passer sur la Loire quand il se rendait à sa maison de Chauvon ». Un autre historien de l'Anjou , faisant état de documents puisés dans Grandet, signale que le prieur de l'abbaye de Cunault « relevait directement du roi, auquel il devait, à titre de service féodal, fournir un bateau pour faire le voyage de Saumur aux Ponts-de-Cé, avec douze hommes d'armes pour sa garde ».
Un bail passé le 30 septembre 1746 , entre Mademoiselle Paulmier et un de ses fermiers, stipule la redevance suivante : « Il devait venir charger son batteau chaque fois qu'elle se rendait à Angers ».
Après avoir donné la définition du mot touée , l'un des auteurs de « Glossaire des patois et parlers de l'Anjou » ajoute une note : « Je possède la grosse d'un bail dont la minute fut receue par Jean-Augustin Poullain, notaire à Montjean, le 7 frimaire, an VIII, par laquelle Etienne Plumejeau loue à François Trottier la closerie du Petit Fourneau. On y lits : « s'oblige ledit preneur à conduire, chacun an du bail, six touèes de crueaux de pierres le long de l'isleau, aux endroits les plus convenables, pour garantir et empêcher les dégradations du chantier du bas de la rivière ».
Primevert
Les pêcheurs étaient astreints à. acquitter envers le seigneur, tenancier du fief dans les eaux duquel ils exerçaient leur professions la redevance suivante : l'offre du premier saumon pris dans l'année. Ce droit était dit de « saulmonaige » ou encore de « primevert » (prémices). Suivant les seigneuries, existaient des variantes à cette obligation. Parfois c'était le deuxième saumon capturé dans l'année, ou encore la moitié du premier qui étaient exigés, et il arrivait qu'en sus les pêcheurs fussent astreints à livrer le produit de la pêche de toute une nuit.
Voici quelques exemples des modalités d'exercice de ce droit féodal « Le seigneur de Trèves avait le droit de prélever sur les pêcheurs le premier saumon capturé dans l'année. Il donnait cinq sous à qui le lui apporterait ; par contre les autres pêcheurs, appréciation faite de la prise, étaient tenus d'en payer au seigneur la valeur, pour autant qu'elle dépassait cette somme de cinq sous. Chaque filet devait aussi une nuit entière de travail au profit du château »
Seigneurie de Sous-le-Puy « Le seigneur prenait la moitié du premier saumon pêché dans l'année.
La construction d'une pêcherie sur l'Authion, à Chappes par Messire Hilaire de Laval, seigneur du lieu, fut autorisée (1634) « à, charge d'une redevance annuelle de 3 s. et sous l'obligation de tendre tous les jeudis soir les filets afin d'assurer au seigneur tous les vendredis son droit de seinage ».
En 1660, le prieur de Chênehutte, Rivière, fait enregistrer par devant notaire une déclaration au droit de saumonage . La baronnie de Richebourg-Le-Thoureil avait droit de « prémices de saumon, alose, lamproie » .
L'affaire était d'importance et à la réception de la redevance étaient établis des « certificats de présentation » par les pêcheurs du ou premier poisson, saumon: alose ou lamproie pêché »
Par contre, au cas où l'assujetti faisait défaut, il était immédiatement et vertement mis en demeure d'avoir à s'acquitter. Nous extrayons des archives de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur les pièces suivantes concernant le fief de Saint-Florent-le-Vieil :
« Rappel à l'ordre par le prieur de Chênehutte, des pêcheurs ne s'étant pas acquittés de leur redevance (1463-1465) . Sommation par huissier agissant au nom des religieux, adressée à Pierre Benoît, pêcheur au Marinais et autres « de livrer sur-le-champ un saumon qu'ils ont pesché à leurs baillées ordinaires lequel ils doivent à l'abbaye comme étant le premier pesché de l'année dans les limites de ses fiefs » (30 mars 1757). Sentences prononcées par le lieutenant du sénéchal d'Anjou à Saumur, Hugues Payen, contre plusieurs pêcheurs condamnés à payer à Lemaçon et à ses successeurs pour son droit et seigneurie de fonds, fief et domaine dans la Loire : « Le second saulmon que les percheurs compaignons peschans en ung chalen pescheront par chascun an en la rivière de Loire, entre le ponceau des Tuffeaux et la levée de la Loire et depuis led. Ponceau ,jusques au féage de Trèves du cousté du prieuré et de l'autre cousté depuis ledi ponceau jusques à une eschalle de pierre qui fait le département des paroisses de Saint-Martin-de-la-Place et dud lieu de Trèves, lequel devoir est appelé saulmonaige et aussi à pescher par chacun an à la voiglée par une nuytée au dedans des fins et mectes dessusdictes en la saison que les lamproies montent par la dicte rivière de Loire et lui bailler aud. prieur la pesche qu'ils feront. »
Au XVIIIe siècle, la ville d'Angers envoie à M. de Lambsec un saumon saisi à La Flèche par ses domestiques et en demande restitution. Dans le même dossier on note une intervention du Corps de ville dans l'instance intentée au comte de Luzerne contre le droit de Primevert prétendu par lui sur les saumons
S'exerçant, non plus sur les pêcheurs, mais aux dépens des revendeurs de poisson, le droit de doublage consistait pour le seigneur à prendre une alose sur chaque marchand de poisson « expousant en vante en ceste ville de Saumur une charge d'allouses depuis le feste de Mons. St Eutrope, jusques à la feste de la Trinité durant lequel temps le doublage court et a lieu sur les marchans vendans marchandies » (12 mai 1501).
La baillée aux filles
Le mot baillé était synonyme de manœuvre de la senne. Faire une baillée revenait donc à dire : donner un coup de senne. Parfois, cependant, la baillée désignait la senne elle-même .
Nous rappellerons seulement en quelques lignes l'essentiel de cette coutume, d'origine féodale, croit-on. Elle est bien connue des Angevins et fut souvent décrite par nos historiens régionaux.
Faut-il attribuer la paternité de l'institution de cette fête populaire au roi René ? Rien ne permet de l'affirmer, bien que le « roi des gardons » fut traditionnellement déclaré grand ami de la gent des pêcheurs. Voici en quoi consistait ce divertissement. Après vêpres, le jour de la fête de l'Ascension, les filles de pêcheurs, de dix-huit à vingt ans, toutes renommées pour leur beauté et l'élégance de leurs coiffes, se rendaient en bateau à l'île des Aireaux. Là, et pour une fois dans l'année, elles maniaient la senne : faisaient une baillée. L'élue de leur groupe, dit la tradition, se rendait ensuite près du roi, stationnant sur la rive au milieu de la foule. Elle lui offrait un beau poisson qui était (ou passait pour être) le fruit de la pêche. Le roi l'embrassait et la dotait pour son prochain mariage qui devait se faire avec un pêcheur.
Plus tard, le gouverneur du château prit la place du roi et présida le divertissement. Au cours des âges, l'usage de jeter la senne se perdit et la fête ne gagna pas en prestige, mais, jusqu'à la fin du siècle dernier, les Angevins continuèrent à venir se promener le jour de l'Ascension aux Ponts-de-Cé et y consommaient des « bouilletures » dans les guinguettes
Droit d'épave
Le droit d'épave permettait au seigneur de s'approprier toutes les choses charriées par les cours d'eau bordant ou traversant ses terres ou rejetées sur les rives. Les archives de l'Anjou nous livrent quelques textes faisant mention de cette coutume.
Dans l'énumération de ses droits seigneuriaux, le seigneur Goislard de Monsabert rappelle « J'ay droit de toutes épaves tant par eau que par terre»
A Gennes, la seigneurie de Sous-le-Puy « avait le droit de confiscation sur les chalans et autres barques ou toutes autres épaves qui échoueraient en la rivière sur l'étendue du fief » .
Dans une lettre, l'évêque d'Angers Hardouin s'adresse, le 29 mars 1384, à la justice pour régler le différend qui l'oppose à l'abbaye de St-Georges-sur-Loire concernant le droit d'épave « en la rivière de Loire et au lieu appelé le Port Girault » .
L'abbaye de St-Florent de Saumur jouissait sur le Thouet du même privilège « droits... des épaves... dans la rivière du Thouet » (1407).
Par sentence rendue le 6 juillet 1500, le juge ordinaire d'Anjou signifie aux religieux de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur la recréance de leurs droits « de naufrages et épaves nobiliaires ».
« Le seigneur de Saint-Jean avait droit. d'épave ».
Enfin, nous voyons l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire donner ajournement à cinq délinquants. « pour envahissement de grèves et d'épaves lui appartenant » (9 décembre 1456).
Voici une liste d' « espaves » de peu d'importance dont s'était emparé le prévot de Saumur. Elles furent ultérieurement remises à qui de droit : le prieur d'Offard (Saumur) dont le logis et la chapelle étaient construits sur les ponts, à la tête d'un îlot (île d'Offard), dépendances de l'abbaye de Saint-Florent :
« Remise à frère Guillaume du Plessis, prieur d'Offard, par Jean Nicolas, lieutenant de Saumur, « d'un chapperon rouge, une houppelande de gris, deux couteaulx en une gayne » et autres objets trouvés sur la rive droite de la Loire, dans le fief du prieuré et indûment saisis par Guillaume Lemaître, prévôt de Saumur, sous prétexte qu'ils appartenaient au duc d'Anjou comme espave à cause de la dicte prévôté (l'an mil CCCLX dix huit) » .
Sous la même rubrique (H-3191) et concernant ce même prieuré d'Offard, nous voyons renouvelée l'affirmation du droit d'épave au prieur Thomas Laurent. Ce dernier possédait en effet « en ses fiez et juridictions toutes manières d'espaves et aubenages (18 décembre 1400) ».
Les naufrages, nous l'avons vu, étaient fréquents. Le dommage subi par le marinier était aggravé par la saisie du bateau sinistré, de ses agrès et des marchandises transportées, par le seigneur riverain. Les M.F. s'insurgèrent de bonne heure contre une telle injustice. Au nombre des premiers actes de la corporation, en 1382, nous voyons figurer une supplique adressée au roi pour solliciter son intervention en faveur de l'un des leurs, victime de ce droit abusif. Un chaland chargé de sel, échoué dans le Cher, fut réclamé et saisi, malgré la résistance des mariniers, par les officiers de justice du seigneur de Saint-Aignan. La compagnie de M.F. adressa une « complainte » au roi, sollicitant son intervention pour la remise du bateau et de sa cargaison à son propriétaire. Les solliciteurs terminent en réclamant l'autorisation qu'ils fussent dorénavant « en possession seuls de prendre et s'appliquer leurs bateaux, chalands, apparaux, denrées et marchandises en quelque lieu qu'elles soient trouvées, toutes et quantes fois que elles sont aventurées, afondrées ou péries en la rivière et fleuves dessusditz »
Pour la même raison, nous voyons la corporation intenter un procès au seigneur de Chantocé en Anjou. Dans son arrêt, la Cour du Parlement stipule:
« Si aucun vaisseau ou bateau, par cas de fortune ou autrement, enfondre ou périt es limites de la chatellenie de Champtocé, le seigneur n'y pourra prétendre aucun droit»
A force d'opiniâtreté, les mariniers, forts de l'appui de la royauté, arriveront à obtenir de bonne heure, sur tout le cours de la Loire, la disparition d'un droit féodal particulièrement révoltant.
Péages
L'obligation pour le bateau de s'arrêter au bureau de péage en vue de l'acquittement des droits grevant les marchandises transportées était également une entrave à la navigation. Le droit de péage, d'abord régalien, devint ensuite féodal et fut finalement recouvré par la royauté.
Les péages se multiplièrent surtout au Moyen Age. Chaque seigneurie, dont le territoire était baigné par la Loire (ou toute autre rivière navigable), érigea un bureau de perception sur la rive. Les seigneurs justiciers étaient possesseurs des chemins de terre et des voies fluviales. L'exigence, pour la traversée, du versement d'un droit, devint une fiscalité qui se propagea rapidement. Les intérêts royaux rejoignaient ceux des nautonniers. Affaiblir les féodaux en supprimant leurs prérogatives faisait le jeu de la couronne et l'abolition d'un grand nombre de péages rendait la voie plus libre aux navigants sur le fleuve.
Procès-Verbal aux Lombardières
Rapport du notaire pour un Procès-verbal d'avarie survenu à Rochefort aux Lombardières le 10 mai 1775
« Lesquels nous ont dit qu'il leur était arrivé un accident hier au soir sur les dix heures avant soleil couché, que suivant une lettre de voiture d'Angers du huit de ce mois signée Besnoit. Ils étaient chargés de quatre-vingt milliers d'ardoises quarrée forte et de vingt milliers de cartelettes pour le compte de Monsieur Mainguet négociant, acheté à messieurs Andrieu frère et fils aîné négocians à Nantes, qu'ils avaient chargé cette ardoise carrée dans deux grands bateaux qui sont un chaland et une sapine en très bon état, la sapine toute neuve qui n'avoit encore point servie que venir de l'endroit où elle avoit été construite, qu'ils avoient partis hier sur les dix heures du matin de la ville d'Angers pour se rendre à leur destination. »
En sorte qu'il y a quarante-six milliers d'ardoises quarrée de perdues et seize milliers de cartelettes qu'il est impossible de tirer de l'eau, vu la profondeur et la rapidité du courant de la rivière
Source:Navigation en Loire par FOURREAU
La Pêche
René BOURIGAULT de Béhuard
Maître Pêcheur en Loire en1697
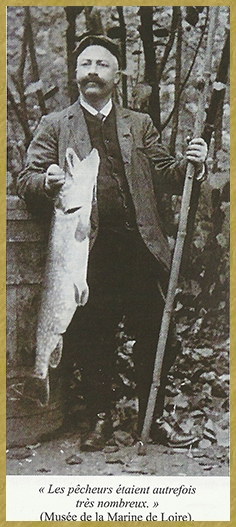 De tout temps, la pêche en Anjou fut une activité importante. À la fin du Moyen Âge, du fait d'une réglementation légère, les pécheurs professionnels étaient nombreux. Ils constituaient une population importante et variée des tours d'eau. Tout un petit monde vivotait du produit de la pêche.
De tout temps, la pêche en Anjou fut une activité importante. À la fin du Moyen Âge, du fait d'une réglementation légère, les pécheurs professionnels étaient nombreux. Ils constituaient une population importante et variée des tours d'eau. Tout un petit monde vivotait du produit de la pêche.
À cette époque, les pêcheurs sont intimement liés aux bateliers. Aux assemblées générales tenues à Orleans, ils prennent place à côté d'eux comme délégués des marchands fréquentant la rivière de Loire. Même si leurs activités sont différentes, pécheurs et mariniers vivent sur le fleuve, et ils sont amenés à manœuvrer des bateaux.
À partir du XVIe siècle, comme dans chaque corporation, les pécheurs devaient souscrire à un contrat d'apprentissage.
À qui appartiennent les eaux et les pêcheries ?
Le Roi a la propriété éminente des eaux et forêts. Comme il a besoin d'argent, il délègue « connaissance et juridiction » à ses sujets, seigneurs hauts justiciers, sous la tutelle du grand maitre et des officiers de la « Maitrise des eaux et forêts ».
3 décembre 1633. Lettre du roi, Louis XIII, à la généralité de Tours :
Le sieur Bautru, (seigneur du comte de Serrant), conseiller en notre Conseil d 'Etat, nous ayant requis de lui accorder de lui faire don des Iles et des accroissements qui se sont faits dans la rivière de Loire, nous vous avons convoyé le placet (supplique) qui m'a été présenté. par ledit sieur de Bautru en considération des services qu’il nous rend journellement tant en sa charge qu’en autres occasions très importantes, nous vous demandons et ordonnons de prendre en considération (sa demande) »
Béhuard fait partie de la châtellenie de la Roche-de-Serrant incluse dans le Comte de Serrant. (Archives de Serrant, liasse 1026.)
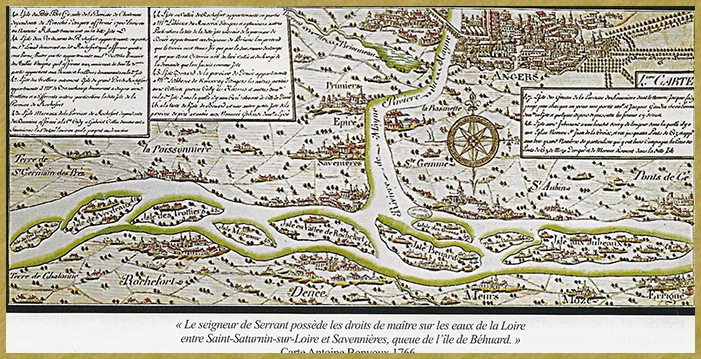
Le seigneur Bautru paiera au roi une redevance pour bénéficier des droits de maitre sur une grande partie des eaux de la Loire entre Saint-Saturnin-sur-Loire et la queue de l'île de Béhuard ; il possèdera également le droit de port et de passage. Ses successeurs conserveront ces droits jusqu'à la Révolution. Ainsi, propriétaire du droit de pêche, en tant que maitre, Bautru pouvait choisir les « maitres pêcheurs » et leur designer une paroisse. Ceux-ci étalent surveilles par les services des Eaux et Forêts, et la non-observation des règlements pouvait les emmener devant la Justice.
En 1669, Louis XIV et son ministre Colbert, contrôleur général des finances, créent :
« La Grande ordonnance »
Dont un chapitre porte sur la règlementation de la pêche et des pêcheries. « Ordonnance de 1669. Edit portant sur le règlement général pour les eaux et forêts. Saint-Germain-en-Laye. »
Art. XXII. Du titre de la pêche :
1) Défendons à toute personne, autre que les maitres pêcheurs reçus aux sièges des maitrises par les maitres particuliers ou leurs lieutenants, de pêcher sur les fleuves et rivières navigables, sous peine de 50 livres d'amende ; en outre, confiscation des filets et autres instruments de pêche pour la première fois, et pour la seconde de 100 livres d'amende, avec pareille confiscation et même de punition plus sévère selon le cas.
2) Nul ne pourra être reçu maitre pécheur qu'il n'est au moins lâge de 20 ans.
3) Les maitres pêcheurs de chacune ville ou port, où ils sont au nombre de huit ou plus, éliront tous les ans aux assises un maitre de communauté qui aura l'œil sur eux et avertira les officiers des maitrises des abus qu'ils commettront ; et dans les lieux où il y en aura moins que huit, ils convoqueront ceux des prochains ports ou villes pour ensemble en nommer un d'entre eux.
4) Défendons à tous pêcheurs de pêcher aux jours de dimanche et de fête, sous peine de 40 livres d'amende, et pour cet effet, leur enjoignons expressément d'apporter tous les samedis et veilles de fêtes après le soleil couché, au logis du maitre de communauté tous leurs engins et harnais, lesquels ne leur seront rendus que le lendemain du dimanche ou fête, après le soleil levé, sous peine de 50 livres d'amende et interdiction de pêché pour un an.
6) Les pêcheurs ne pourront pécher durant le temps de fraye depuis le 1er février jusqu'au 1er juin sous peine de 20 livres d'amende et d'un mois de prison ; double peine pour la seconde fois ; fouet et bannissement pendant cinq années pour la troisième fois.
12) Les pêcheurs rejetteront en rivière les truites, les tanches et gardons qui en auront moins de cinq pouces : confiscation contre les pêcheurs et marchands de carpes brèmes et mouniers n'ayant pas 6 pouces de longueur entre l’œil et la queue.
13 Voulons qu'il y ait en chaque maitrise un coin dans lequel l'écusson de nos armes sera gravé et autour le nom de maitrise, duquel on se servira pour sceller en plomb les harnais et engins des pêcheurs, qui ne pourront s'en servir sans que le sceau n'y soit apposé, sous peine de confiscation et vingt livres d'amende ; et sera fait un registre des harnais qui auront été marqués et du nom du pêcheur qui les aura fait marquer.
Tous les maitres-pêcheurs de nos rivières et ceux des particuliers qui ont droit de pèche sur les fleuves et rivières navigables répondront pour les délits qu'ils y commettront par devant les officiers des maitrises et non par devant les juges des seigneurs auxquels est interdite la connaissance, et seront condamnés suivant la rigueur de nos ordonnances.
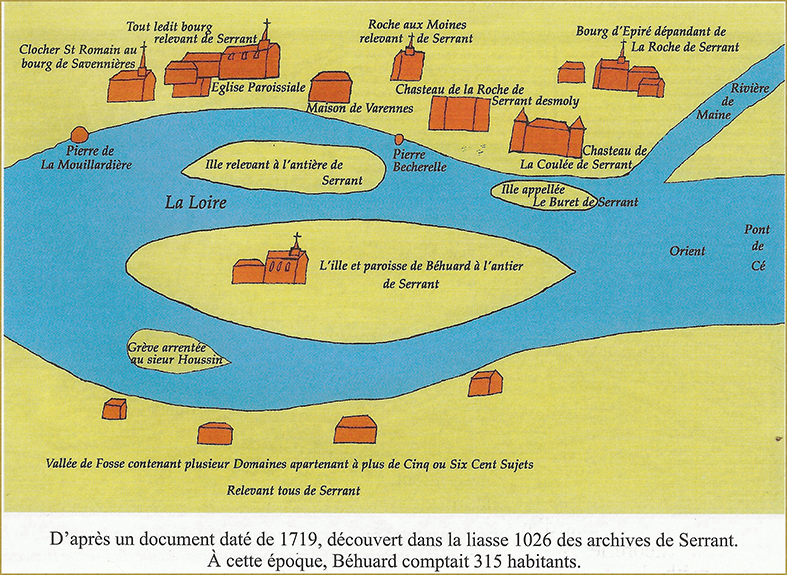
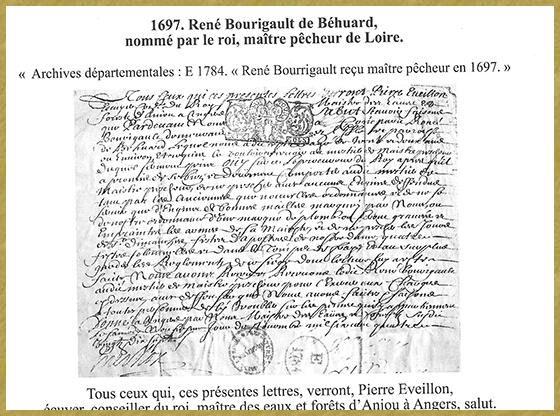
Savoir, faisons que, par devant nous, a comparu René Bourigault demeurant en île et paroisse de Béhuard, lequel nous a dit être âgé de trente et deux ans ou environ, et requiert le vouloir recevoir au métier de maitre pêcheur, duquel serment pris..
Sur ce, le procureur du roi, après qu'il a promis de se bien et dûment comporter audit métier de maitre pêcheur, de ne pêcher avec aucuns engins défendus tant par les anciennes que nouvelles ordonnances et de ne se servir que d'engins de bonnes mailles marques par nous ou de notre ordonnance d'une marque de plomb ou seront gravées ou empreintes les armes de sa majesté et de ne pêcher les jours de saints, dimanches, fêtes d'apostolat ?... de Notre-Dame, quatre fêtes solennelles et dans le temps de fraye et au surplus garder les règlements de ce siège dont lecture lui a été faite.
Nous avons rep et recevons ledit Rene Bourigault audit métier de maitre pêcheur pour l'ex... aux charges ci-dessus avec défenses que nous avons faites et faisons à toute personne de l'y troubler sur les peines qu'ils y appartiennent.
Donné à Angers par nous maitre des eaux et forêts susdit, le samedi neuvième jour de novembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
La pêche en Loire fut très importante jusqu'au siècle dernier. Les poissons recherchés étaient au nombre de cinq : le saumon, l'alose, la lamproie, l'anguille, le brochet. Les « blancs », quant à eux, étaient l'objet d'une pêche destinée à la consommation locale ou personnelle. À noter que quatre de ces poissons ont une vie partagée entre le milieu marin et le milieu fluvial. Aujourd’hui, ces poissons migrateurs, du fait de l’aménagement du fleuve, ont bien du mal à atteindre leurs frayères. Ils sont donc désormais beaucoup moins nombreux, et notamment le saumon qui n’est plus pêché parce qu'il fait actuellement l'objet de protection.
Le brochet qui est sédentaire survit difficilement à l'abaissement de la ligne d’eau de la Loire. En effet, cette baisse ne permet plus aux prairies, frayères naturelles des brochets, d'être inondées régulièrement. Malgré tout, la pêche professionnelle est encore un peu pratiquée, surtout celle de l'anguille d'avalaison. En revanche, nombreux sont encore les amateurs qui pêchent l'anguille selon la méthode ancestrale, c'est-à-dire a la bosselle. »
Article de Ma. Monique Clavreul
(1) La pescherie (pêcherie). 1606. Dictionnaire Robert.
Lieu aménagé pour une entreprise de pêche. « Nous voici au milieu des pescheries, des barques, des filets tendus », écrivait Pierre Loti.
Deux pêcheurs, Pierre Richou et Pierre Marchand, déclaraient, dans les années 1670 à 1684, une pescherie, appelée l'escluse (écluse) en la boire du Louet (Port-Godard), pour laquelle ils payaient 5 sols de cens.
Sources : Archives de Serrant, liasse 1026. Lettre de Louis XIII.
Archives départementales : E 1784. « Rene Bourrigault rem maitre pêcheur en 1697. » Isambert, Decrusy et Taillandier. « Ordonnance de 1669. Edit portant règlement général pour les eaux et forêts. Saint-Germain-en-Laye.
(Archives Gens d'Louere) « Batellerie et métiers de la rivière en Loire angevine ». P. 18
Conseil Général
La Pêche Fluviale-Conseil General du Maine et Loire de 1879
M. Chevalier donne lecture du voeu suivant du Conseil d'arrondissement d'Angers sur la pêche fluviale :
« Le Conseil, consulté sur les modifications qu'il lui paraîtrait utile d'apporter au règlement sur la pêche fluviale en Maine-et-Loire, signale à M. le Préfet, pour y faire droit, après étude, les demandes des pêcheurs des communes de la Possonnière et Behuard qui lui sont soumises par M. Deperrière.
« Les pêcheurs demandent :
1° Le rétablissement de l'ancienne tolérance qui leur était accordée avec l'ancien règlement, de pratiquer de jour et de nuit la pêche aux poissons de mer qui remontent le fleuve de la Loire à certaines époques.
A défaut de cette tolérance absolue, les pêcheurs sollicitent qu'il leur soit au moins accordé deux heures de pêche avant et après le coucher du soleil. Cette dernière faveur qui paraît leur avoir été accordée par l'arrêté de M. le Préfet, en date du 7 Avril 1879, approuvé par décision ministérielle en date du 8 mai 1879, est parvenue à leur connaissance, à tel moment, qu'ils n'ont pu en jouir, disent-ils, que pendant quelques heures. Les pêcheurs exposent que la pêche de jour est à peu près improductive quand les eaux ne sont pas troublées et que la pêche de nuit seule leur procurerait un travail rémunérateur.
2° Les pêcheurs sollicitent le rétablissement du droit de pêche à la maille de 27 millimètres pour tous les engins traînants. Ils exposent qu'avec la maille de 40 millimètres, actuellement obligatoire, la pêche devient difficile et impraticable pour certains poissons. Ils font valoir, en outre, la perte que leur cause l'application du nouveau règlement qui leur interdit l'usage de leur ancien matériel.
3° Les pêcheurs demandent le rétablissement du droit de pratiquer partout la pêche à la vouillée, à maille de 27 millimètres, pendant tout le temps que la pêche est ouverte, sauf à interdire ce système de pêche pendant le frai du dard qui a lieu du 15 février au 15 mars environ. »
1893 deuxième session
A la veille de l'échéance du 1er janvier 1893, à laquelle les baux de la pêche devaient être renouvelés, M. Deperrière avait fait connaître l'agitation existant parmi les pêcheurs du canton de Saint-Georges, relativement à la question des filets fixes ou barrages en Loire dont ils disent la suppression absolument nécessaire; il avait même lu à ce sujet, à la session de 1893, une pétition faite par les pêcheurs de Behuard.
Le Conseil n'a jamais cessé, dans ses précédentes sessions, sur la proposition de M. Deperrière, de renouveler les vœux les plus pressants en faveur de cette industrie. Après avoir entendu MM. le Dr Cordon, Houdet et Deperrière qui déclarent que les poissons de toutes espèces disparaissent dans la Loire, il reste plus énergiquement que jamais dans sa tradition, en demandant la suppression des barrages de pêche établis en Loire, contre toute sagesse, eu égard à la reproduction des poissons, et contre toute réserve, eu « égard aux intérêts de nos pêcheurs indigènes, »
Source Conseil General du Maine et Loire de 1879
Source Conseil General du Maine et Loire de 1893 deuxième session
Poissons de Loire
En 1752, Duhamel du Monceau fait l'inventaire des poissons remontant et nous parle de saumon, d'alose, de lamproye, de lamprion, de couvert (espèce d'alose), de civelle, de chevrette ou écrouelle, de mulet blanc, de plye, de truite. Aujourd'hui, certaines de ces espèces ont malheureusement disparu de la Loire ou n'existent plus qu'à l'état endémique.
Parmi les grands migrateurs présents sur le front atlantique on trouve le saumon, l'alose, l'anguille, la truite de mer, la lamproie, voire l'esturgeon. Tous ces poissons naissent en eaux douces puis descendent rivières et fleuve jusqu'à la mer, ne les remontant que pour se reproduire. Une exception cependant pour l'anguille dont les alevins naissent dans la mer des Sargasses et reviennent grandir en eaux douces sous la forme de civelles.
Le Saumon
Le saumon atlantique est le plus emblématique des poissons du bassin de la Loire.
Ce noble animal, grand voyageur, reste fidèle à la rivière où il a vécu ses premiers instants. Dès lorsqu'il mesure quinze centimètres, avec une couleur argentée, ce migrateur se déplace jusqu'au large de la Norvège pour trouver sa nourriture. Passant sa vie en mer, il retourne dans le fleuve où il est né pour s'y reproduire.
Les saumons parcourent plus de 800 kilomètres en Loire pour remonter jusque dans le haut Allier à commencer par les plus gros, ceux de 15 kilos, certains pouvant atteindre le poids record de 20 kilos. Ensuite, suit une deuxième vague de saumons de taille moyenne et en dernier arrivent les plus petits de cinq kilos.
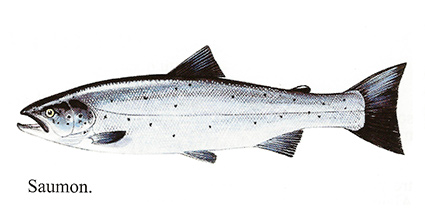 La longueur de ce poisson varie de 50 centimètres à 1,30 m, en même temps que son nom, au fur et à mesure de sa croissance. Le jeune alevin encore en rivière est appelé parc. Lorsqu'il mesure quinze centimètres, sa robe devient argentée, on le nomme alors tacon puis après, smolt. Il est madeleineau quand il a passé un an en mer et a atteint 2 kilos. C'est un madelon quand il remonte le courant, ou un bécard au moment où il change de physionomie : la mâchoire inférieure s'allongeant et remontant vers le haut. En fin de vie, après la ponte, il porte le triste, mais évocateur nom de charognard. Cet animal, d'une grande puissante musculaire, au profil fuselé peut atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 60 kilomètres par heure. Grand sportif, il saute des obstacles et passe les rapides.
La longueur de ce poisson varie de 50 centimètres à 1,30 m, en même temps que son nom, au fur et à mesure de sa croissance. Le jeune alevin encore en rivière est appelé parc. Lorsqu'il mesure quinze centimètres, sa robe devient argentée, on le nomme alors tacon puis après, smolt. Il est madeleineau quand il a passé un an en mer et a atteint 2 kilos. C'est un madelon quand il remonte le courant, ou un bécard au moment où il change de physionomie : la mâchoire inférieure s'allongeant et remontant vers le haut. En fin de vie, après la ponte, il porte le triste, mais évocateur nom de charognard. Cet animal, d'une grande puissante musculaire, au profil fuselé peut atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 60 kilomètres par heure. Grand sportif, il saute des obstacles et passe les rapides.
L'Anguille
 Arrivée sur la côte atlantique, l'anguille connaît trois stades de développement : civelle, anguille jaune, anguille argentée.Au printemps, la civelle portée par le Gulf Stream traverse l'océan Atlantique pour rejoindre les côtes d'Europe. Sa taille est à ce moment-là de 55 à 90 mm. Certaines se développent alors dans l'estuaire, dans les vasières et marais, dans les parties basses du fleuve.
Arrivée sur la côte atlantique, l'anguille connaît trois stades de développement : civelle, anguille jaune, anguille argentée.Au printemps, la civelle portée par le Gulf Stream traverse l'océan Atlantique pour rejoindre les côtes d'Europe. Sa taille est à ce moment-là de 55 à 90 mm. Certaines se développent alors dans l'estuaire, dans les vasières et marais, dans les parties basses du fleuve.
D'autres entament une remontée du fleuve pour retrouver plus en amont des zones appropriées à leur développement. À l'état adulte, en se sédentarisant, elles deviennent « anguille jaune ». L'anguille jaune se pêche aux bosselles, aux nasses, aux verveux. Actuellement, la règlementation autorise cette pêche cinq mois par an.
À l'heure de sa maturité, elle va migrer vers la mer des Sargasses en redescendant d'abord la Loire et d'autres rivières. C'est à cette époque qu'on la pêche au guideau sur le fleuve. Lorsqu'elle est « avalante », elle est appelée « l'anguille argentée ». On la capture également sur l'Erdre, la plaine de Mazerolles, le canal de Nantes à Brest, la Vilaine et le lac de Grand-Lieu.
La Lamproie

Cet animal qui est « presque un poisson » ressemble à un fossile vivant. Il ne possède pas de mâchoires. Sa bouche en forme de ventouse est équipée de dents acérées. Son corps cartilagineux est recouvert d'une peau sans écaille avec un mucus aussi visqueux que toxique. Sept orifices branchiaux lui servent à respirer de chaque côté.
Le cycle biologique de la lamproie se décompose en trois parties.
La première phase dure à peu près cinq ans. Elle naît en eaux douces. Enfouie dans un fond meuble, seule la tête de la larve ressort pour se nourrir en filtrant l'eau, ne conservant que des éléments organiques et des particules d'algues. De toute cette période n'apparaît aucun développement marquant. Elle est alors une ammocète.
La deuxième phase de son existence est réservée à sa croissance, les yeux se forment, puis le disque buccal ainsi que les dents. Elle mesure 12 à 15 cm lorsqu'elle se dirige vers l'estuaire et la mer. Elle y vivra tel un vampire, se fixant aux poissons qu'elle vide de leur énergie en plaquant sa bouche pour y faire ventouse. Les dents transpercent la proie, la langue coupante attaque les chairs. Elle «pompe » ainsi sa victime jusque dans l'abdomen ou elle fait un festin des oeufs s'y trouvant, ne laissant aucun liquide y compris le sang. L'animal tracté pendant tout ce temps sur quelque trois cents kilomètres succombera bien sûr à cette opération. Inversement à d'autres pour qui les déplacements coûtent beaucoup en énergie, la lamproie, gloutonne au possible et se dépensant peu pourra atteindre 1,20 m de longueur et peser 2,5 kg.
Parmi ses proies favorites, on trouve bar, saumon, hareng, morue, espadon, églefin, lieu, alose, merlu, thon.... Des mets que nous savons également apprécier.
Dans sa troisième période de vie, à l'heure de sa maturité sexuelle, ce sera l'abstinence totale.
C'est le retour vers les eaux douces et les zones de frayères. En décembre elle atteint l'estuaire et remonte les cours d'eau. En première partie de mai, le mâle fait le choix du lieu des amours et l'aménage à l'aide de sa queue. Puis il se fixe à la tête de la femelle qui fait ventouse sur une pierre. Ce phénomène dure plusieurs jours et le mâle y laissera sa vie.
Dans l'estuaire, la pêche se fait au filet tramail dérivant, plus haut, sur le fleuve, c'est à l'aide de nasses, autres fois en osier.
Les Portugais autant que les Espagnols apprécient beaucoup la lamproie. En France, c'est en Aquitaine qu'elle est le plus consommée.
L'Alose
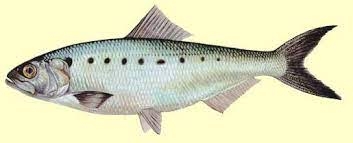 L'alose dite grande alose se retrouve dans les fleuves de la façade ouest de la France et de la Manche.Elle est de belle apparence avec une robe aux reflets bleus, mauves et verts, et le ventre tout de blanc nacré.
L'alose dite grande alose se retrouve dans les fleuves de la façade ouest de la France et de la Manche.Elle est de belle apparence avec une robe aux reflets bleus, mauves et verts, et le ventre tout de blanc nacré.
Dans sa phase adulte, entre 3 et 8 ans, la grande alose mesure de 50 à 60 cm pour un poids fluctuant entre 1,40 et 1,80 kg, les femelles restant plus longues que les mâles. En mars, les aloses reviennent de mer pour retrouver les zones de frai dans le fleuve ou les rivières où elles sont nées. La reproduction se situe, en général, entre mi-mai et mi-aout, quand la température est correcte pour déclencher le processus de frai. Le mâle meurt généralement après l'accouplement, pour cause d'épuisement.
L'éclosion faite, les alosons se confondent avec les ablettes le long des frayères attendant une certaine maturité pour rejoindre l'océan en banc. Cette expédition dure de trois à six mois. L'hiver venu, les aloses auront atteint la mer. Au bout de trois à huit ans, elles reviennent vers leurs zones d'eau douce pour perpétuer leurs cycles.
Le Mulet
 On reconnaît le mulet à sa couleur grise avec des reflets métalliques sur les côtés, et à son ventre blanc. Sa taille peut aller jusqu'à 70 cm pour un poids de 2,50 kg. Sa longévité varie de 8 à 10 ans et il est mature entre trois et quatre ans.
On reconnaît le mulet à sa couleur grise avec des reflets métalliques sur les côtés, et à son ventre blanc. Sa taille peut aller jusqu'à 70 cm pour un poids de 2,50 kg. Sa longévité varie de 8 à 10 ans et il est mature entre trois et quatre ans.
Passé sa première année, le jeune mulet reste proche des côtes pour s'alimenter de crustacés et d'alevins. Au bout de trois ou quatre ans, la croissance terminée, une grande partie d'entre eux commence une remontée des eaux douces. Ce poisson se nourrit alors de végétaux ou de déchets organiques. Dans le fleuve, on le capture de mars à décembre.
C'est un poisson apprécié du point de vue culinaire.
La Plie

Se nourrissant en grande partie de jeunes crevettes blanches, la plie est abondante au début du XXe siècle dans l'entrée de l'estuaire où elle remonte jusqu'à Nantes et le lac de Grand-Lieu. Elle a pour habitude de se tapir sur des fonds sablonneux où elle prend la couleur de son environnement. Aujourd'hui, elle est devenue rare, on la pêche d'août à novembre.
La Truite de Mer
 Elle se distingue de la truite fario, de rivière du fait qu'elle passe une partie de sa vie dans l'océan : de quelques mois à deux ans, elle reste dans les eaux continentales pour se développer. Elle remonte ensuite vers les eaux douces, entre avril et juillet, pour se reproduire en décembre. Les juvéniles attendent un à deux ans avant de reprendre la mer. Son cycle biologique est semblable à celui du saumon. Les trois quarts des géniteurs là aussi périront.
Elle se distingue de la truite fario, de rivière du fait qu'elle passe une partie de sa vie dans l'océan : de quelques mois à deux ans, elle reste dans les eaux continentales pour se développer. Elle remonte ensuite vers les eaux douces, entre avril et juillet, pour se reproduire en décembre. Les juvéniles attendent un à deux ans avant de reprendre la mer. Son cycle biologique est semblable à celui du saumon. Les trois quarts des géniteurs là aussi périront.
La truite adulte a un poids moyen d'un kilo, sa taille se stabilise entre 35 et 50 cm.
L'esturgeon

L'esturgeon européen est une espèce potamotoque, capable de vivre une quarantaine d'années et d'effectuer plusieurs cycles biologiques.
La reproduction intervient en eau douce, à une profondeur d'environ 5 m dans des habitats de graviers grossiers. Les juvéniles passent l'essentiel de leur développement en estuaire, de l'âge de trois à sept ans. Durant cette phase de vie, les juvéniles évoluent en estuaire et effectuent quelques migrations littorales avec des retours en estuaire essentiellement au printemps. Après cette phase de développement de plusieurs années, l'esturgeon européen part en migration maritime dans son aire de répartition sur le plateau continental. C'est au cours de cette phase que les esturgeons européens acquièrent leur maturité sexuelle, à l'âge de 10 à 12 ans pour les mâles et de 13 à 16 ans pour les femelles.
Les adultes reviennent en estuaire entre janvier et octobre, avec une période principale en avril et mai en hautes eaux. La période de reproduction est observée un mois après leurs retours, essentiellement fin mai, en eau douce
Un esturgeon pêché en Loire ? Encore une histoire de sardine qui a bouché le port ? Non, Frédéric David n'est pas Marseillais. Mais Angevin. Il a pêché dimanche matin un esturgeon, du côté de Behuard, qu'il a remis à l'eau. 1,12 m et 10 kg pile-poil
Source:Ouest France du 14/09/2016
Un esturgeon également fut pris à Behuard en 1811: « Cet individu était long de 2 mètres et pesait 70 kilos. Une peinture en aurait été faite. Le tableau, déposé dans la chapelle de Behuard, y serait resté quelques années seulement »
Source=livre Angevine et MaineSource=pêche et pêcherie en Basse Loire
Le Sandre

Le sandre est un poisson difficile à pêcher. Il change régulièrement de zone d'évolution qu'il choisit en fonction de la luminosité, de la teneur en oxygène, de la présence de nourriture et de la structure de la zone. Il faut être un pêcheur aguerri, capable de présenter son leurre avec précision.
Le sandre est un grand carnassier qui mesure à 6 ans entre 60 et 70 cm pour un poids d'environ 3,5 kg. Les pêcheurs peuvent espérer croiser des spécimens de 20 ans mesurant 1,20 m et pesant 12 kg. Mais le plus fréquemment est de croiser des spécimens de 40 à 50 cm pesant entre 1 et 2 kg. Son corps est élancé et sa tête est allongée. La bouche porte une dentition forte. Il est de couleur gris-verdâtre sur le dos, plus clair sur les flancs qui sont marqués de bandes verticales sombres. Son ventre est blanc-jaunâtre. Les nageoires caudale et dorsales sont marquées de points réunis en taches sombres.
C'est un poisson lucifuge qui guette sa proie dans des milieux où il est difficile à repérer. La luminosité du milieu aquatique est très variable car elle dépend notamment de la couleur de l'eau, du moment de journée, de la météo. Moins il y a de lumière à l'extérieur et plus le sandre se rapproche de la surface et inversement.
Lorsqu'il est jeune, le sandre consomme d'abord du plancton puis commence à goûter à des invertébrés (des larves, des vers, des insectes divers). Une fois adulte, il mange des poissons de petite taille. Mais il continue à consommer des vers et des larves diverses. Ce poisson chasse en groupe. Rassemblés, ils se ruent sur leurs victimes qu'ils tuent et blessent au passage. Ils n'ont plus qu'à refaire le chemin inverse pour consommer les cadavres et les blessés.
Le Brochet
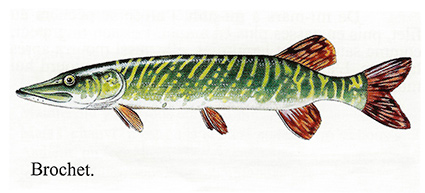 Le brochet fait également partie des poissons carnassiers difficiles à capturer : d'où le fait qu'il est particulièrement convoité par les pêcheurs, qui ont l'espoir d'en attraper un qui mesure au moins 1 mètre de longueur, la taille légale de capture du brochet étant de 60 cm en France. Certains pêcheurs expliquent même que la pêche au brochet relève plus du sport que du loisir et qu'il demande de déployer toute la technicité dont on est capable : serrer le frein de la ligne lorsqu'il fatigue, desserrer lorsqu'il se propulse… À chaque poisson, le combat diffère.
Le brochet fait également partie des poissons carnassiers difficiles à capturer : d'où le fait qu'il est particulièrement convoité par les pêcheurs, qui ont l'espoir d'en attraper un qui mesure au moins 1 mètre de longueur, la taille légale de capture du brochet étant de 60 cm en France. Certains pêcheurs expliquent même que la pêche au brochet relève plus du sport que du loisir et qu'il demande de déployer toute la technicité dont on est capable : serrer le frein de la ligne lorsqu'il fatigue, desserrer lorsqu'il se propulse… À chaque poisson, le combat diffère.
À quoi ressemble cette cible tant convoitée ? Son bec est pourvu de plus de 500 dents tranchantes comme des lames à rasoir et sa robe est verte, parsemée de pigmentations jaunes. C'est un poisson très musclé qui possède une grande puissance de nage, d'où la finesse qu'il faut déployer pour ne pas casser son matériel. C'est aussi un expert du camouflage et de la chasse à l'affût. Ses couleurs lui permettent de se fondre dans le décor. Il attend et bondit lorsqu'une proie passe à sa portée. Comme le sandre, il aime les eaux calmes et se plaît particulièrement dans des zones où la végétation aquatique comme les nénuphars, les potamots, les roseaux, offre une belle densité
Le Goujon
 Le goujon est synonyme de pêche à la friture. Une ligne fine suffit à l'attraper car c'est en effet un poisson de petite taille. Trouver la zone de pêche s'avère en revanche plus technique car il n'est pas si fréquent. Si vous marchez dans la Loire, le sable soulevé et les petits insectes qui y vivent et qui sont perturbés par votre passage, attirent les goujons qui viennent alors manger à vos pieds. On peut le trouver en compagnie de barbeaux, de vairons et de truites. Lorsqu'ils sont capturés, ils mesurent généralement une dizaine de centimètres. Son aspect le rend discret sur des fonds graveleux où, avec les fonds sableux, il se plaît. Il passe l'essentiel de son temps à fouiller le fond à l'aide de ses deux barbillons. Cette espèce est assez unique et ne peut guère être confondue avec une autre.
Le goujon est synonyme de pêche à la friture. Une ligne fine suffit à l'attraper car c'est en effet un poisson de petite taille. Trouver la zone de pêche s'avère en revanche plus technique car il n'est pas si fréquent. Si vous marchez dans la Loire, le sable soulevé et les petits insectes qui y vivent et qui sont perturbés par votre passage, attirent les goujons qui viennent alors manger à vos pieds. On peut le trouver en compagnie de barbeaux, de vairons et de truites. Lorsqu'ils sont capturés, ils mesurent généralement une dizaine de centimètres. Son aspect le rend discret sur des fonds graveleux où, avec les fonds sableux, il se plaît. Il passe l'essentiel de son temps à fouiller le fond à l'aide de ses deux barbillons. Cette espèce est assez unique et ne peut guère être confondue avec une autre.
La Carpe

La carpe est un poisson originaire d'Asie qui fut introduit en France au Moyen-âge ; la belle taille de ce poisson assurait l'alimentation de grandes familles. Aujourd'hui, alors que les difficultés à se nourrir ne concerne plus qu'une minorité de personnes, elle a disparu des assiettes car elle présente peu d'intérêt gastronomique : la chair est certes ferme et grasse mais n'est pas aussi fine que celle du sandre.
Mais depuis les années 80 et le développement de la pratique du No Kill qui consiste à relâcher le poisson après sa prise, les pêcheurs s'intéressent de nouveau à la carpe. Ce poisson est de forme allongée et trapue, recouverte de grosses écailles et présente une bouche portant 4 barbillons. Au-delà de ce descriptif succinct, son aspect peut beaucoup varier au sein de la même espèce.
La Brème

La brème est un poisson grégaire, calme qui aime les eaux à faible courant et évolue à une profondeur de 3 à 4 mètres. Les gros spécimens peuvent atteindre jusqu'à 70 cm et un poids de 6 kg. Mais plus couramment, ce poisson mesure entre 30 et 50 cm pour un poids oscillant entre 0,5 et 2,5 kg. Son corps est plat. Sa tête, petite, porte une bouche protractile qui se déplie vers l'avant. Ses couleurs varient en nuances autour du bronze, son dos est gris vert et son ventre plus clair.
Le Barbeau
 Le barbeau a un corps allongé et musclé, ce qui en fait un poisson combatif pour pêcheur amateur de sport. La couleur de son corps est entre gris et bronze foncé et il porte des nageoires orangées, un ventre blanc et plat qui lui permet de rester sur le fond de l'eau. Sa bouche équipée de 4 barbillons dirigée vers le bas lui sert à fouiller les graviers du fond en quête de nourriture. Il vit en banc. Il recherche les milieux riches en oxygène et donc des eaux vives. Il est omnivore.
Le barbeau a un corps allongé et musclé, ce qui en fait un poisson combatif pour pêcheur amateur de sport. La couleur de son corps est entre gris et bronze foncé et il porte des nageoires orangées, un ventre blanc et plat qui lui permet de rester sur le fond de l'eau. Sa bouche équipée de 4 barbillons dirigée vers le bas lui sert à fouiller les graviers du fond en quête de nourriture. Il vit en banc. Il recherche les milieux riches en oxygène et donc des eaux vives. Il est omnivore.
Le Silure
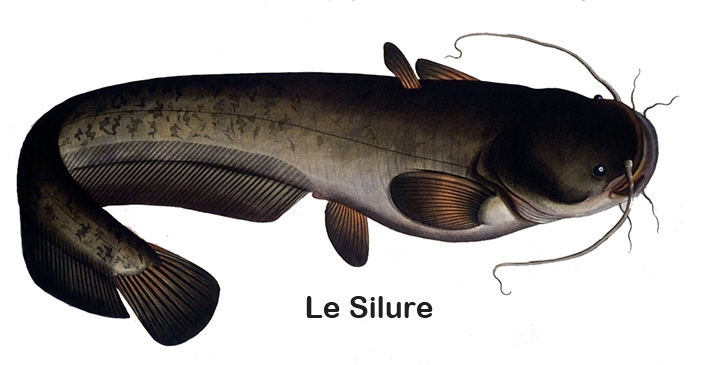
Est un poisson sans écaille avec une peau vert-brun très glissante car recouverte de mucus. Son ventre est assez clair, de couleur jaune ou blanc et il existe également des spécimens albinos de couleur jaune, jaune-orangé. La tête du silure est massive et plate avec une grosse bouche dotée de lignes de dents très petites et nombreuses orientées vers l'arrière de sa gueule. Il possède six barbillons : deux longs sur la mâchoire supérieure et quatre courts sur la partie inférieure de sa tête. On compte quatre nageoires : une anale, une dorsale munie d'un aiguillon et des pelviennes de chaque côté également munies d'un dard. Les silures mesurent environ 1,5 m de long en moyenne et les poissons de plus de 2 m sont de plus en plus communs, pour un poids allant de 50 à 150 kg. Les plus gros silures atteignent des tailles allant de 2,65 à 2,75 m, le record dans les eaux françaises étant de 2,74 m
Poisson-chat et silure : deux familles bien distinctes
Les origines du poisson-chat et du silure
- Le poisson-chat est une espèce nord-américaine importée en France vers 1870. Son introduction s'est produite accidentellement alors qu'un musée d'histoire naturelle nettoyait ses bassins. Le poisson aurait alors rallié la Seine, en passant par le réseau d'égouts, puis tout l'hexagone. Il a ensuite rejoint la mer du Nord et les Balkans ;
- Le silure est originaire d'Europe centrale où il colonisait le Danube, la Volga et la Dniepr. Son introduction, imputée à la pêche sportive, a concouru à sa propagation en Europe occidentale (France, Allemagne, Italie, Espagne). On le rencontre aujourd'hui dans tous les grands axes fluviaux de l'Hexagone, y compris la Seine.
Les siluriformes constituent un ordre regroupant les poissons-chats (ictaluridés) et les silures (siluridés). Réunissant près du quart des  espèces de poissons d'eau douce, les siluriformes seraient âgés de plus de 110 millions d'années et auraient donc connu les dinosaures ainsi que l'extinction massive du crétacé. Mais avant d'aller plus loin, il est important d'apporter une précision. En effet, le terme "poisson-chat" est souvent utilisé pour définir l'ensemble des siluriformes, donc toutes les espèces munies de barbillons. C'est d'ailleurs à ces sortes de moustaches rappelant les vibrisses du félin, qu'elles doivent leur nom. Au sens strict, le poisson-chat (ameiurus melas) désigne une espèce de poisson considérée comme invasive en France et dont il est question ici. Gros plan sur les spécificités de chacune des espèces.
espèces de poissons d'eau douce, les siluriformes seraient âgés de plus de 110 millions d'années et auraient donc connu les dinosaures ainsi que l'extinction massive du crétacé. Mais avant d'aller plus loin, il est important d'apporter une précision. En effet, le terme "poisson-chat" est souvent utilisé pour définir l'ensemble des siluriformes, donc toutes les espèces munies de barbillons. C'est d'ailleurs à ces sortes de moustaches rappelant les vibrisses du félin, qu'elles doivent leur nom. Au sens strict, le poisson-chat (ameiurus melas) désigne une espèce de poisson considérée comme invasive en France et dont il est question ici. Gros plan sur les spécificités de chacune des espèces.
La tête du poisson-chat et du silure
- Le poisson-chat possède une tête large et plate munie d'une énorme gueule renfermant des dents courtes, pointues et coniques. Sa bouche se pare de grosses lèvres et de 8 barbillons, longs et bien développés, dont 6 pendent sous la mâchoire inférieure et 2 se dressent derrière les narines. Ses petits yeux se placent latéralement sur chaque côté de la tête ;
- Le silure arbore une tête massive et plate recelant des lignes de dents très petites et nombreuses qui s'orientent vers l'arrière et forment une râpe. L'espèce présente 6 barbillons: 2 longs et mobiles sur la mâchoire supérieure et 4 petits non mobiles sous la mandibule. L'œil placé haut est minuscule par rapport à la taille de cet animal lucifuge (qui évite la lumière).
La peau du poisson-chat et du silure
- Le poisson-chat revêt une peau nue, recouverte d'une épaisse couche de mucus et parfois de plaques osseuses. Son dos est brun (vert maronné à presque noir), ses flancs sont plus clairs et le ventre est blanc jaunâtre.
- Le silure se couvre également d'une peau très visqueuse et dépourvue d'écailles. Il affiche une livrée grise à verdâtre, marquée par de nombreuses marbrures plus foncées. Son ventre est clair, allant du blanc au jaune pâle.
La taille du poisson-chat et du silure
- Le poisson-chat mesure entre 15 et 20 cm et pèse de 100 à 300 g. Le record serait détenu par un spécimen de 45 cm de long pour un poids de 1,8 kilo .
- Le silure peut aisément dépasser 2,5 m de long et 100 kilos quand il bénéficie d'une nourriture abondante dans son habitat. Le plus gros silure pêché en France est annoncé à 2,74 m et le record du monde serait établi à 2,80 m dans le fleuve Pô, en Italie.
L'espérance de vie du poisson-chat et du silure
- Le poisson-chat a une longévité de 6 à 7 ans
- Le silure vit généralement de 15 à 20 ans (maximum 40 ans).
La réglementation concernant le poisson-chat et le silure
- Le poisson-chat est un animal très vorace et prolifique qui colonise facilement les cours d'eau. En France, il est considéré comme une espèce nuisible qui perturbe la biodiversité en décimant les espèces autochtones. La loi interdit de le transporter vivant et de le relâcher.
- Le silure est un poisson protégé par l'annexe III de la convention de Berne. En France, il n'est pas considéré comme une espèce invasive susceptible de causer des déséquilibres biologiques. L'animal figure sur la liste des espèces de poissons "représentées", c'est-à-dire que son introduction est libre, sous réserve que les individus proviennent d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés.
Bateaux de Loire
Le Gabarreau
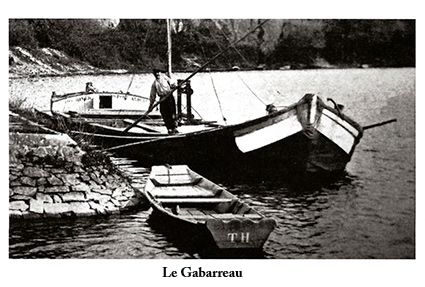
Le gabarreau (ou gabarot) fait la transition au niveau de sa construction entre le traditionnel chaland ligérien et celui de basse Loire qui, de la fin du XIX' au début du XXe, fut le dernier chaland à naviguer. Ce gabarreau hérite en particulier à sa poupe du tableau des chalands, mais avec un gouvernail axial qui est une évolution primordiale sur le fleuve et ses rivières. À l'avant, la réalisation d'une étrave permet de gagner en volume.
La construction de ce type de bateau appartient tout particulièrement au secteur mayennais où sont implantés les chantiers. Si ce bateau est pensé pour la navigation sur les canaux, il répond néanmoins parfaitement à la navigation sur les rivières du sous-bassin de la Maine, mais avec des dimensions moindres pour les besoins locaux. Il est fréquent, à cette époque, de rencontrer des gabarreaux de 16 à 18 mètres de long transportant pour la ville d'Angers principalement la chaux, le sable ou bien le gravier des rivières produit dans la région. Même si ce gabarreau apparaît sur la Loire autant que sur les rivières du pays nantais, son homologue, plus long d'une dizaine de mètres, évolue lui sur la Loire et ses canaux. C'est le frère quasi jumeau du chaland de basse Loire dont il est inspiré, la seule différence de ce nouveau chaland réside dans la présence de l'étrave à l'arrière à l'égale de l'avant, tout en conservant le gouvernail axial.
Le chaland moderne
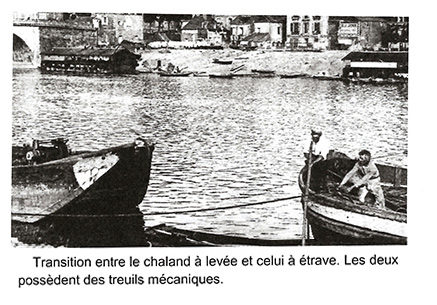
Au début du XXe siècle, le transport par eau sur la Loire s'est modernisé. Même si le moteur n'est pas encore sur ce type de bateau, il y a déjà une révolution. Les chalands naviguent seuls ou par deux avec une embarcation légère flanquée, ou en remorque. Les grands trains de bateaux ont disparu. La piautre est remplacée par un gouvernail axial d'étambot à barre franche.
On remarque aussi que le mât ne s'incline plus vers l'avant mais sur l'arrière. L'avant du bâtiment est à étrave et non plus à levée ; cela se prête mieux à un trafic situé en particulier sur la basse Loire, là où l'on utilise rivières et canaux à rives franches avec des ports correctement adaptés. L'arrivée du treuil mécanique à démultiplication transforme radicalement la morphologie du bateau et la logique économique du transport.

S'il fallait auparavant tout un équipage pour manœuvrer le guinda, un homme suffit avec ce nouveau treuil. Les personnes de labeur embarquées se limitent au patron et à son compagnon, souvent le fils. La suppression du guinda entraîne la libération d'un important espace à l'arrière permettant l'installation d'un habitat sommaire, mais assez vaste pour y vivre en couple. La femme du marinier monte donc à bord et tout en continuant son travail de ménagère, peut participer aux manœuvres en tenant la barre, peut assurer les amarrages, aider aux passages d'écluses, etc. Le métier de marinier devient familial et artisanal, alors, disparaissent les grandes entreprises de transport fluvial.
Le chaland de Basse Loire

Le chaland de Basse Loire parfois nommé par erreur, « chaland nantais » fut construit pour l'essentiel en Anjou, mais également à Nantes, dans le pays nantais et en Bretagne.
Ce terme de chaland nantais est apparu dans les années 1980 à travers des écrits du moment.
Dans la relativement longue période de son existence, la presse parle simplement de chaland, l'ensemble des documents administratifs reprend ce terme. L'appellation « basse Loire » le différencie des autres grands chalands qui naviguent à ce moment-là. Sa longueur gravite autour de 26,50 m et comme les grands gabarreaux sarthois, il se démarque des autres grands bâtiments qui frôlent parfois les 32 mètres à cette époque.
Sa morphologie lui permet dans la région de Nantes et en particulier au canal de Nantes à Brest d'accéder aux passages étroits des écluses des canaux, ce qui explique sa concentration entre l'Anjou et la Bretagne. Ce chaland bénéficie alors de toutes les avancées technologiques de l'époque. Il va rapidement dominer pour prendre, sur la dernière ligne droite de la batellerie traditionnelle à voile, le dessus sur les autres grands bateaux.
Ce bateau fait des escales à Nantes pour déposer ou retirer sa marchandise, mais peut traverser la ville sans s'y arrêter pour se rendre directement dans l'estuaire où on le retrouve jusque dans le petit port de Corsept ou celui de Saint Nazaire. Mais il peut aussi se déplacer sur l'ensemble des rivières navigables : Acheneau, le Tenu, l' Ognon, la Boulogne via le lac de Grand Lieu, en empruntant le canal de Buzay .Il s'aventurera aussi sur la Sèvre et la Maine, en passant l'écluse de Vertou.
Un comptage de ces bateaux y compris les gabarreaux, d'une longueur moyenne de 26,50 m, sur leur période globale de construction, donne les éléments suivants : il en a été construit 133 en Anjou, 25 en Bretagne, 17 en région Nantaise et 90 à Nantes même.
Les chantiers nantais ne fournissent donc que le tiers du marché global, mais plus tard ils se démarqueront par la quantité de bateaux construits dès lors que la coque bois sera transformée en coque métal. En effet, ces chantiers sont rôdés de longue date à la maîtrise de la construction métal avec les bateaux maritimes.
Description du bateau
Les grandes lignes de ce bâtiment sont dessinées en rapport avec les écluses du canal de Nantes à Brest qu'il devra emprunter. D'un chantier de construction à l'autre et d'une période à une autre, les différences ne résideront qu'à travers d'infimes détails comme le démontrent les devis suivants par exemple, les quelques décimètres variant dans sa longueur. Est-ce là le choix du client ou celui du constructeur qui, ici, les distingue ?
Ces bateaux comme tous les grands chalands sont fabriqués en chêne champêtre, dit de taillis.
Plus dense que le chêne de futaie, il est aussi plus résistant dans le temps. Ces bois sont utilisés non séchés pour les fonds et demi secs pour le bordage. Les plus petits diamètres des troncs, dépourvus d'aubier, ne sont pas inférieurs à 0,50 m
Ci-dessous, exemple d'une demi-coupe du bateau. On retrouve la configuration des bateaux de canaux en général y compris, le chaland navigant sur le canal de Berry.
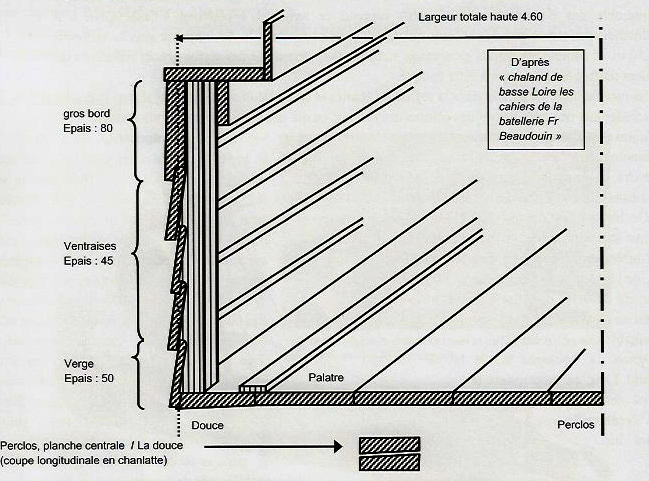
Le chaland de Loire et son évolution
La batellerie en basse Loire persiste malgré une concurrence qui, somme toute, aura force de puissance à terme, le transport par voie de chemin de fer. Le bateau, lui évolue sans doute trop timidement. Les idées neuves sur la Loire sont pourtant mises en application depuis un longtemps dans l'estuaire tout proche, sur des bateaux devant affronter l'océan. La toue ligérienne d'estuaire s'équipe d'un gouvernail axial sur une levée arrière, technique empruntée aux bateaux maritimes.
Vers 1880, c'est l'aboutissement en matière de perfectionnement et de nouveautés sur le bateau bois du fleuve. On y retrouve tout ce que la lente évolution a glané depuis plus d'un siècle : le gouvernail axial avec ferrure et mèche équipé d'une barre franche se substitue à la piautre, pièce imposante pouvant peser plus d'une tonne. Ce gouvernail est positionné sur l'axe médian d'un tableau droit qui remplace la levée arrière et qui a la particularité de capter la force du courant pour la transmettre au bateau alors qu'avec une levée, le flot glisse dessous pour le dépasser.
L'autre avantage, sensible, est d'augmenter la surface plate du fond du bateau, permettant un plus faible enfoncement de même qu'il conservera une meilleure constante dans la route qui lui est donnée.
Les treuils mécaniques à démultiplication de force placés à l'avant et à l'altière.
L'abandon du castro et du vemeau, anciennement structures de maintien de pied de mât, disparaissent, dégageant là aussi de grands volumes même si un sentineau entre deux cloisons, dans le sens de la largeur, y prend place. Le pied de mât et son articulation entre deux jumelles se trouvent alors au-dessus du pont et s'incline dorénavant vers l'arrière.
L'étrave a définitivement remplacé la levée qui perd de son utilité sur les canaux ou les ports aménagés dans la mesure où les embarquements se font sur les flancs du bateau. La levée avait son intérêt au XVIIIe siècle quand la plupart des ports n'étaient composés que de rives en pentes douces que les embarcations approchaient par l'avant. Cette levée a aussi l'inconvénient de réduire les volumes exploitables.
L'étambot, autre forme d'étrave à la partie arrière du bateau, se substitue au tableau devenu une constante sur les plus grands bateaux.
La suppression du guinda, treuil fixe de grande dimension généralement placée en travers du bateau servant à assurer l'ensemble des manoeuvres importantes à bord. C'est un fût de bois transversal, sur les anciens chalands, avec des poignées fichées à chaque extrémité et pouvant faire un mètre de long, approchant les deux mètres sur les chalands sarthois. Cette disparition laisse place à un plus grand volume pouvant constituer un habitat.
Le Gabarreau sablier
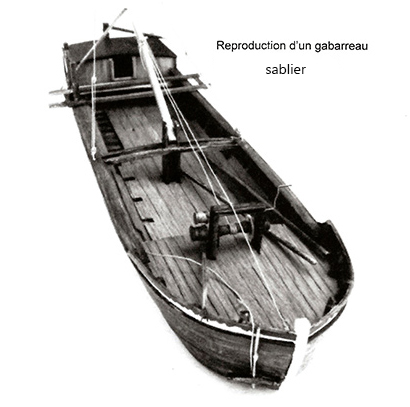
Il se différencie du chaland de basse Loire uniquement par le tableau qu'il possède à l'arrière. Les chantiers de construction se situent sur les bords de la Mayenne.

Aboutissement du bateau à coque bois, le chaland de basse Loire, historiquement plus contemporain que le gabarreau. Le principal chantier est à Montjean sur Loire.
Evolution du bateau ligérien
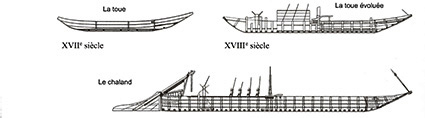
Ancienne forme des bateaux de Loire avec une levée également à l'arrière.
Chaland, début du XIX' siècle avec une levée avant. La différence : un tableau arrière équipé d'une piautre.
Le bateau dit « accéléré », première partie du XIXe, de petite, moyenne ou grande taille est inspiré des coques marines aux
flancs arrondis, avec un début de tableau arrière qui permet de recevoir un gouvernail axial
Grand chaland de Loire, deuxième partie du XIXe siècle, pouvant dépasser les 31 mètres de long. il est équipé de tous les avancements techniques de l'époque, mais, victime de sa démesure, il est condamné à rester sur le fleuve. Il devra céder sa place au chaland de basse Loire qui, afin d'accéder aux canaux pour des raisons économiques, reviendra à une longueur inférieure à 27 m. longueur des écluses.
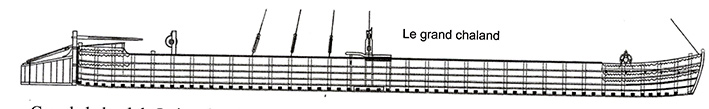
Histoire du chaland
Le chaland a servi de support à toutes les innovations à venir, lui-même descendant de bateaux ancestraux tels que la grande toue à deux levées qui à l'époque atteignait les 16 mètres. Ce chaland, appelé parfois et par erreur « gabarre » car la gabarre était une embarcation d'estuaire, fut le plus caractéristique de la flotte ligérienne. Les côtés sont réalisés avec des planches de bord superposées à l'endroit des liaisons longitudinales appelées clins, et fixées à l'aide de chevilles de bois. Ces recouvrements sont généralement de l'ordre de 10 cm.
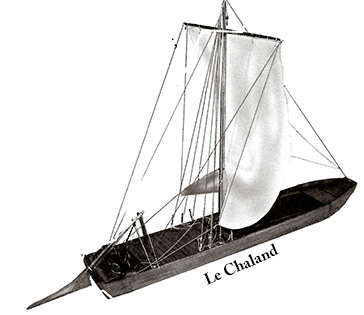 À vide, la ligne de flottaison se situe aux environs de 45 cm avec un chargement de 50 à 80 tonnes. L'enfoncement de 80 cm à un mètre varie avec la densité et la quantité du fret. À partir du XVIIIe, ce chaland évolue selon les besoins économiques et il prendra toute sa dimension à la fin de ce même siècle.
À vide, la ligne de flottaison se situe aux environs de 45 cm avec un chargement de 50 à 80 tonnes. L'enfoncement de 80 cm à un mètre varie avec la densité et la quantité du fret. À partir du XVIIIe, ce chaland évolue selon les besoins économiques et il prendra toute sa dimension à la fin de ce même siècle.
Dans l'évolution continuelle du bateau et pour une quête de rentabilité, celui-ci gagne toujours en volume, il s'élargit et surtout s'allonge. Dans la deuxième moitié du XVIII siècle, ses dimensions sont importantes, pas loin de 26 m. Il n'évoluera guère à ce niveau pendant ce siècle. Il se démarque au niveau du pont par un guinda à l'arrière que l'homme, par sa force s'applique à rendre puissant : c'est un cabestan horizontal sans démultiplication ni encliquetage antiretour qui s'impose longtemps.
Son bordage reste à clin, les membrures sont monoxyles , le chevillage est de rigueur, les arronçoirs ainsi que sa levée avant ne le quittent pas. Le mât et la surface de voile prennent de l'ampleur.
Les grands mouvements économiques se développent ; le fleuve, à cette époque, est la seule ouverture possible pour assurer une liaison internationale. Les voyages s'allongent, ce bateau a donc de l'avenir et fait naturellement la transition entre les toues arrivant directement du moyen-âge et les futurs chalands modernes.
Source=navigation en Loire Armoricaine
Bateaux de pêche
La toue ou cabane de pêche

Le bateau lui-même nommé toue, par sa conception, apporte stabilité et confort de travail.
À l'époque où la pêche se pratiquait de nuit, les pêcheurs s'abritaient dans la « cabane », abri assez spacieux qui d' ailleurs, donna son nom au bateau lui-même, « la cabane ». De ce fait, il pouvait atteindre les quinze mètres. Depuis que ce travail de nuit est interdit, l'homme rentrant le soir à son domicile, cette cabane n'a plus de raison d'être aussi grande. Alors, naturellement, la longueur du bateau diminue, dépassant rarement les dix mètres, mais sa largeur reste constante, entre deux mètres cinquante et trois mètres.
Aménagement d'une cabane
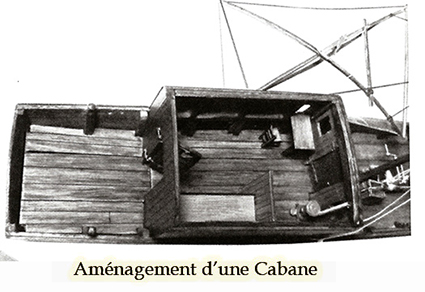
L'habitat d'une cabane reste sommaire. Une ou deux chaises dans la mesure où deux pêcheurs peuvent y loger. Une modeste table avec devant et sur le côté de petites ouvertures pour l'observation. Un petit poêle à bois, un coin repos. Une porte à l'avant, une autre pour accéder à l'arrière.
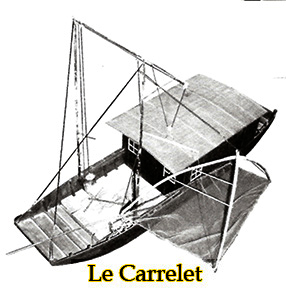
Il devra rester de la place pour entreposer du matériel, bottes et vêtement, ainsi que quelques bûches. Quelques victuailles et sans doute journal et jeu de cartes.
Le carrelet peut également être suspendu par un portique métallique. La structure des derniers carrelets était aussi métallique.
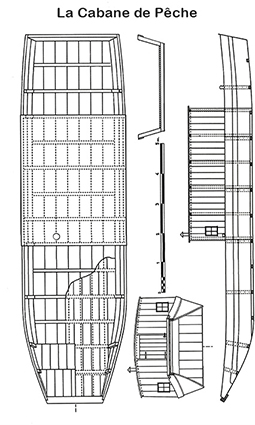
Le Futreau
 Le futreau, appelé parfois et surtout par les administrations bachot, sert de bateau annexe. Celui-ci est équipé d'une corne.
Le futreau, appelé parfois et surtout par les administrations bachot, sert de bateau annexe. Celui-ci est équipé d'une corne.
En saison de pêche, le pêcheur, laissant son bateau sur place, rejoint la rive à l'aide d'une embarcation légère, généralement un futreau si ce n'est une plate ou barque. Il l'utilise également pour l'installation du filet-barrage ou pour le remonter le soir.
La corne servira à transporter les prises du jour jusqu'à la bascule.
Le futreau que l'on voit toujours amarré le long des berges de Loire et de ses affluents et qui ressemble à une toue moyenâgeuse en miniature, est parfaitement autonome. Grâce à une levée à chaque extrémité, les embarquements et débarquements se font aisément tout en limitant les manœuvres.
Les côtés, réalisés avec deux ou trois planches, forment les bordées montées à clin reliées par des chevilles de bois, plus tard par des clous retournés à l'intérieur. Les vestiges de certains de ces bateaux nous montrent une structure faite de courbes dites monoxyles, c'est-à-dire, de pièces de bois courbes, d'un seul morceau, partant de la liaison d'un tronc ou d'une branche avec une autre branche.

Vivre avec l'Eau
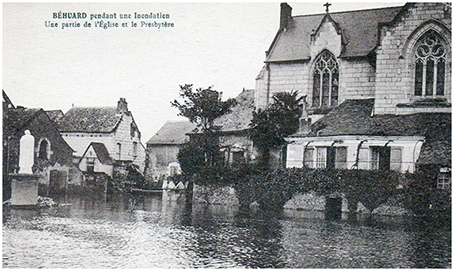
Le village resta jusque vers la fin du XIXe siècle desservi uniquement par des passeurs et des bacs. Après les dévotions de Louis XI à Behuard, les pèlerins venaient de plus en plus nombreux. On y arrivait par bateaux d'Angers et des paroisses voisines en pèlerinage. En tant que desserte de Denée, les habitants de l'île, pour remplir certains devoirs paroissiaux, devaient traverser deux bras de Loire pour se rendre à ladite église de Denée. La situation s'était améliorée du fait que les îles dénommées à cette époque « la Vacherie » et « l'île de Mer-Madame » venaient grâce à un ensablement naturel se rattacher à L'île Marie », (celle où s'élève la chapelle), pour n'en former qu'un tout.
Les habitants de Behuard s'alliaient presque exclusivement entre eux. Rarement un batelier ou un cultivateur traversait la Loire ou la Guillemette pour aller chercher femme aux Lombardières, à Denée, Rochefort ou Savennières. Cinq ou six familles descendent encore de ces vieux insulaires et il leur est aisé de trouver leur ascendance jusqu'au XVIIe siècle. Sur les registres de la paroisse on trouve un Cady fermier au Merdreau, un Boussard pêcheur, un Réthoré laboureur, un Richou pêcheur, un autre Richou fermier, Pierre Baudry tisserand, Matthieu Le Doyen tonnelier, René Bourigault closier de l'île Griveau, Gabriel et Pierre Colin ainsi que François Richou au Bas-Griveau
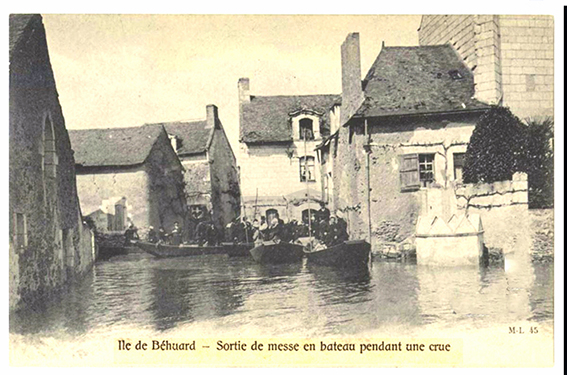
On ne compte plus le nombre de fois où le village a été envahi par les eaux. Ne le fut-il pas sept fois dans l'année en 1866 ? Depuis ce début du siècle les crues les plus hautes furent atteintes en :
1910 : avec 7 mètres à l'échelle gravée dans l'ardoise près de l'église.
1923 : 6 m. 56 1952 : 6 m. 35
1936 : 6 m. 68 1977 : 6 m. 28
1941: 6 m. 59 1982 : 6 m. 84
En ces temps d'inondations, Behuard est une Venise sans gondoles, mais avec des plates que l'on manie très précisément à la perche car d'autres formes de bateaux ne permettraient pas de naviguer sur des eaux si peu profondes parfois et en emmenant tant de personnes à la fois
La Noel en Behuard Inondé(1910)
Conte publié dans la presse et signé "le Vieil angevin", repris, ici, à l'occasion du centenaire de la crue de 1910.
Avec mes bons amis, "Doran.ge" des "Bas-Grivaux", j'avais comploté, en plein cœur de l'été, de faire réveillon à la Noël prochaine, en leur maison rustique, là-bas, en queue de l'île. Mais nous avions compté sans la traîtresse Loire et la terrible crue ! Au lieu d'emprunter les chemins creux de l'île, je dus me risquer à faire la passée sur des champs inondés par un fleuve courroucé.
L'embarquement
En descendant des "Forges" par le dernier courrier, au bas de la grand'côte qui mène en Epiré, je hélais d'un « Oh ! Eh », à l'accord bien senti, le "Vieux-Pierre", le passeur, aux moustaches blanchies, raide comme sa grande perche, long comme un jour sans pain. L'écho me répondit, dans la nuit tout obscure, par un autre « Oh ! Eh ! », d'une forte tournure.
Quelques temps après, un clapotis de l'eau m'annonce l'arrivée de mon vieux marinier ; son futreau, en glissant sur l'onde frissonnante, aborde là, tout près de l'auberge tentante, où bien souvent, l'été, la foule de pêcheurs s'amuse, boit et devise en attendant le train qui vient, placide et lent, jusque de Saint-Laurent, tout bondé d'Angevins.
Un bref colloque s'engage, et toujours les mêmes phrases à la façon d'antan : « Comment Pierre, ça va ! - Et de vot 'part, Monsieur Jules ». Franche poignée de main. Embarquement hâtif sur le grand futreau plat, qui m'attend là, tranquille, tout amarré qu'il est au têtard de l'allée.
La Passée
Pierre prend la grande perche, moi la lourde godille. Nous passons à travers ce que fut son jardin avant la crue subite, évitant les poiriers dont seuls les fins scions émergent du courant, tremblant comme les balises qui, en été, des grèves, dénoncent la traîtrise. D'un coup d'épaule, aussi hardi que sûr, mon marinier, rompu au rite dès son enfance, imprime sur sa perche le bref mouvement scandé qui fait glisser l'esquif devers la sablière.
Le silence qui règne sur cet immense lac qui va jusqu'à Denée, est fort impressionnant, tout estompé qu'il soit par la faible lumière d'un quartier tout jaunet de notre astre lunaire. Au fond, tel un grand doigt s'élance vers le ciel, le schiste découpé de la Pierre-Bécherelle et l'on devine à peine de l'île les fins contours aux têtes des "bouillerées" dont les longues racines sortent pendant l'été des eaux de la Guillemette au cours traître et rapide.
La manœuvre énergique nous met en plein courant. Nous saluons en passant le village du Bois, la maison à Payrault, la ferme à Cyprien. Longeant enfin le pré de feu l'ami Touchais, nous arrivons tout droit au fameux "port des Branches".
Terre !
Virant dans le remous, nous saisissons bien vite le chemin que dessinent des troncs de frêne bien bas. Il nous mène tout de go chez la vieille mère Thomas. Un arrêt fort brutal brusquement me chancelle. Adieu, dès ce moment, aux savantes manœuvres. Adieu perches, godilles... Terre, crie Pierre Boussard, tel un nouveau Colomb.
Là-haut, emprisonnées dans l'aiguille d'ardoise, se démènent, mutines, quatre cloches de bronze au son presque argentin, et tout comme Frère-Jacques y chantent les matines ; elles semblent "les mâtines", en ce beau soir, vouloir s'échapper de leur cage pour aller chez Taunay, à l'hôtel Notre-Dame, réveillonner à l'aise avec le bon vieux coq descendu de la croix.
J'aborde, près du logis qualifié de "royal", tapi bien humblement là, tout près du rocher, revêtu de mousse sombre... La Vierge de pierre, en sa niche profonde paraît, en ce soir-là, sourire doucement à ses enfants sur l'onde.
Je frôle des bateaux, frère de notre futreau qui me mène en ces lieux... D'indécises silhouettes se profilent dans l'ombre, de nouveaux arrivants s'infiltrent jusqu'à nous, faiblement éclairés par de vagues "rouzines" (chandelles de résine) fichées au "pont" avant, tout comme les limousines, jadis, au bon vieux temps.
Et montant les degrés du royal escalier de schiste, fatigué par les pas et les ans, je gagne enfin la porte aux gonds rouillés grinçants de la gothique église. En passant sous l'ogive aux tuffeaux salpêtrés, j'entrevois tout à coup, par la rustique orée, le "Temple" illuminé des feux follets mystiques sortant du brasillement de mille cierges teintés d'un ivoire patiné.
L'offrande du roi
Déjà au maître-autel de la noble chapelle, que domine là-haut la Vierge vénérée, toute noircie qu'elle est par les cierges et les ans, un prêtre, surchargé d'un manteau très antique, psalmodie lentement la "généalogie" du Christ-Fils-de-Dieu. En rythme bien scandé les "génuit" succèdent à d'autres "génuit", Judas et puis Pharès, David et Salomon, puis la lignée royale défile dans ce royal palais.
Tout à coup, le silence se fait impressionnant. La cloche de Louis XI, prisonnière tout contre, en sa cage de fer, agrippée au rocher taillé par le ciseau, tinte les douze coups du minuit historique. Et de la porte proche apparaît doucement une longue théorie d'enfants vêtus de blanc. Semblable à saint Maurille, le fondateur du lieu, s'avance un vieil évêque, à la barbe fleurie, (Mgr Pineau, ancien évêque de Colonna, qui longtemps demeura à Behuard, après avoir pris sa retraite).
Chancelant, le prélat porte précieusement un tout petit enfant, tout de rose habillé. Il n'est que de cire molle mais si bien modelé qu'on le croirait vivant. Ce n'est pas vers l'autel tout surchargé de fleurs, de reliquaires, de cuivreries dorées que ses pas se dirigent. Car, au fond de la nef par Louis XI édifiée, se dresse une montagne de papier-peinture qui prétend imiter la grotte de Judée où jadis, pour les hommes, le Fils de Dieu est né. Contre le bœuf et l'âne, Marie et puis Jésus, le vieillard hiératique pose l'enfantelet à l'instant où, là-bas, en terre de Judée, on accomplit toujours ce rite solennel... C'est comme à Bethléem.
Tout à coup, je crus voir les nobles personnages des flamboyants vitraux, s'animer tout tremblants dans leur serti de plomb et frère Nicolas et tous les saints patrons et puis aussi des consoles figées le long des murs sacrés, les statues vénérées par le peuple au passé, quitter leurs habitacles, les chaînes suspendues à l'antique tribune se secouer comme traînées par ceux des prisonniers qui les avaient portées (bref, de vagues fantômes) et tout ce peuple enfin venir s'humilier lentement au maître de céans.
Là-haut, tout près des voûtes, des animaux bizarres se détachant enfin des tanières des stalles et des miséricordes, ramper aussi très doucement avec les mâtins jusqu'au royal enfant.
Le sacrifice
Et l'office commence. Dans la tribune haute, aux stalles destinées, par un roi très madré, au Chapitre rustique dont il avait rêvé, de fortes voix très mâles se mettent à entonner un ardent "Kyrie". Le grec tout francisé par ces voix bénévoles, n'était point déplacé en ce lieu isolé ; et rendait l'expression angoissée et bien noble, de l'homme tout inquiet réclamant à grand cri un sauveur désiré. Sous leurs "miséricordes", des formes sculptées là, en plein bois, paraissaient s'amuser après leur promenade. Les deux chiens allongés se disputant un os, semblaient se quereller plus fortement encore. Naïvement, fixés sur l'ex-voto très proche, les deux enfantelets tout poupins et tout roses souriaient en leur bonnet de mille perles ornés.
Dans l'autre choeur, en bas, des moinillons blancs et diaphanes qu'ils sont, en tunique de lin, s'enflent au "Gloria" pour imiter les anges qui jadis le chantèrent en terre de Judée pour appeler les hommes à la Paix désirée. L'Auguste Mystère s'accomplit à l'instant, au moment où l'Evêque éleva en tremblant le pain de pur azyme fait du blé de la vallée et, puis bien haut ensuite, le calice d'argent qu'offrit aux jours anciens à la reine de céans, un Roy cy-résidant. Et c'est le pur produit du coteau qui nous touche, qui sert en ce soir-là, au Divin Sacrifice. C'est l'Anjou tout entier qui participe à l'office sacré. Les bonnes gens de Behuard n'avaient jamais perçu de spectacle aussi beau, vu Noël si prenant et la vieille "Nothon", tapie dans le recoin des vieux fonds baptismaux engoncée qu'elle était dans sa pelisse fourrée, essuya une larme de sa tremblante dextre qui vint mouiller "un brin", les brides de la coiffe tout empesée et raide.
L'office se termina par une cantilène aussi Moyenâgeuse que les pierres elles-mêmes et puis chacun s'en fut déposée ses présents au pied du bon Jésus... Coutume fort naïve à l'excès, remémorant ainsi l'offrande des bergers à Jésus tout enfant. Mais seul, le roi Louis XI , en son cadre de bois, ne daigne se mêler à cet hommage au roi. Au clocher se démènent les quatre babillardes : car elles sont irritées, n'ayant point obtenu du curé de l'endroit la simple permission d'aller chez les voisins continuer leur chanson.
Le lieu-saint se vide et devient solitaire ; seule la lampe d'or transperce les verrières ; une odeur d'encens, qui semble venir d'Orient, rôde dans la maison.
Le réveillon
Chacun en descendant les marches du "placitre" regagne son futreau. Et dans cette remise enserrée par les eaux, les gondoles toutes noires glissent vers les maisons, faiblement éclairées par le fanal d'avant.
A la voûte éthérée, mille étoiles d'argent piquent de leurs points blancs le dôme obscur des Cieux. Enfin l'on atteignait la maison des Dorange au bout des Bas-Grivaux. Le chien jappa de joie. Un autre dans la nuit lui répondit, là-bas.
Dans une grande salle au lourd plafond chaulé, soutenu d'une poutre énorme en son milieu, la table était dressée... Un festin magnifique. On avait habillé la veille un "gros monsieur". Avec les bons quartiers, on avait cuisiné des choses gouleyantes : saucisses et puis rillaux, fressure, petit-salé, boudin blanc et aussi gogue et jambonneaux. On termina enfin sur la "soupe à la pie" (bouillon gras dans lequel on met du pain et du vin froid). Les flacons succédèrent à d'autres moins anciens, encore plus poussiéreux que leurs vides voisins. On finit l'hécatombe sur une "Marie-Jeanne" de noble "Roche-aux-Moines" de l'an quatre-vingt-treize. Puis maîtresse Dorange découpa le tourteau qui, à deux pas, traînait sur une basse huche bien habillée d'une blanche serviette tissée avec le chanvre du champ au père Taunay.
Mais, tout à coup, l'enfant chéri de la maison, qui, le soir endormi dans la chapelle blanche, avait rêvé tout seul à l'Office des Anges, apparut au foyer, il venait voir ce que l'Enfant-Jésus lui avait déposé en son sabot de bois. Nous l'avons réveillé... et mon petit Jeannot, tout dou, tout doucement grondé, s'en fut se recoucher là-haut, tout en chantant, surchargé des joujoux que lui avait glissés l'autre petit enfant, en la sainte nuitée.
Et nous, presque honteux d'avoir pu réveiller l'innocent endormi, nous quittâmes la table en disant : bonne nuit.
Enfoncé dans la plume de ma couette bouffie, sur les beaux draps de chanvre à la Loire ayant roui, et sentant bon l'iris de tout voisin jardin, je m'endormis enfin quand pointa le matin tout bercé que j'étais du clapotis de l'eau qui lentement battait le vieux seuil d'une ardoise tout usée par les pas. Oh ! la vieille maison aux murs tout quadrillés avec du blanc tuffeau et des pierres verdâtres tirées de Saint-Offange. Doux séjour endormi dans le vaste océan.
Je rêvais moi aussi de cette belle nuitée, je rêvais des chandelles de la crèche et des anges, des moinillons tout blancs, de la voix de stentor du prêtre psalmodiant... enfin du vieux pontife à la barbe fleurie entre ses bras portant : Jésus, divin enfant.
Je vis enfin, guettant cette scène mystique, le roi Louis le onzième, sortir de son vieux cadre de bois tout vermoulu, prendre presque à regret son bonnet tout rembordé d'hermine à pointes noires, rehaussé de reliques, de médailles et de croix, venir très lentement comme jadis les mages, le poser humblement au pied du Roi des Rois. Or, les monstres tapis dans les "miséricordes" regardant aux balustres de l'antique tribune semblèrent, en ricanant, émettre quelques doutes sur la bonne intention de ce royal donnant...
Au ciel, l'étoile d'or disparut lentement.
Le Vieil Angevin
Source: Histoire des Coteaux de Loire et de Maine
![]()